Idées
Après le 16 mai 2 – Paix civile et liberté de penser
On n’est pas condamné à choisir entre la réalité
du despotisme politique et le spectre de l’extrémisme religieux.
Il ne faut pas oublier, en effet, que les extrémistes ont souvent rallié
à leur cause des gouvernements conservateurs et que les deux ont en commun
le désir de combattre la liberté de pensée, la recherche
scientifique et le savoir, considérés comme subversifs.
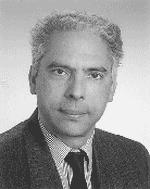
Spinoza, le philosophe européen du XVIIe siècle, a dû faire face à une situation où religion et politique suscitaient de profondes divisions dans la société et alimentaient de dangereuses confrontations. Il a dû quitter, pour un temps du moins, sa tour d’ivoire (sa passion pour la métaphysique) pour affronter une question bien concrète : quelle organisation doit être mise en place pour garantir la paix civile et la liberté de penser ? Sa réflexion nous intéresse au plus haut point, non pas parce qu’elle nous apporte des réponses toutes faites, mais parce qu’elle articule de manière très claire certaines distinctions fondamentales. Elle permet de faire la part des choses dans des conditions où, un peu comme celles que nous vivons aujourd’hui, l’on se croyait condamné à choisir entre la réalité du despotisme politique et le spectre de l’extrémisme religieux.
Les croyances religieuses sont le fondement de la vie collective
Spinoza reconnaît que les croyances religieuses sont essentielles aux hommes, du fait qu’elles constituent le fondement de la vie collective. Toutefois, reconnaît-il, ces mêmes croyances peuvent dresser des obstacles devant la mise en place d’un ordre politique régi par la raison. Ainsi la religion, qui fournit les principes de moralité publique, des normes du juste, de l’injuste et de l’inacceptable, peut en même temps se prêter à des usages qui déstabilisent l’ordre public et portent atteinte aux droits fondamentaux des individus et des groupes. Comment tracer la ligne qui sépare ce qui est nécessaire à un ordre harmonieux des tentatives de déstabilisation ?
Il est possible, nous dit Spinoza, de définir des formes d’observance religieuse qui sont acceptables, qui permettent à ceux qui le veulent de pratiquer et d’exprimer leur foi, tout en respectant les impératifs de paix publique et de liberté d’entreprendre et de penser. C’est l’Etat, le pouvoir central qui doit le faire et il ne doit en aucun cas céder ce privilège à quelque parti que ce soit. Il en va de l’ordre public, de la survie même du pouvoir en place. Autrement dit, c’est à l’Etat de définir les limites dans lesquelles la pratique religieuse doit s’exercer. Cette action porte, bien entendu, sur les formes extérieures de la pratique religieuse, non pas sur les croyances qu’adoptent les individus. La foi intérieure, évidemment, ne peut être l’objet d’un décret de l’Etat. Rien d’ailleurs ne peut justifier le contrôle des esprits par voie d’autorité.
La liberté de croire et de penser n’est pas la liberté d’agir
En d’autres termes, la liberté de croire et de penser n’est pas la liberté d’agir. La croyance et son expression doivent être libres. En revanche, l’observance et les pratiques doivent être contrôlées. C’est à ce prix que la paix publique et les libertés fondamentales peuvent être sauvegardées. Il est donc clair que ceux qui profitent de la liberté d’expression pour enflammer les esprits enfreignent cette règle fondamentale. Leurs discours sont en fait une forme d’action qui s’oppose au contrat politique de base. Ils constituent une forme de désobéissance civile, qui va bien au-delà du droit à la liberté d’expression, de la liberté de croyance ou de penser. Par contre, la liberté attribuée à la pensée rationnelle, même lorsqu’elle soumet les croyances à la critique, n’est nullement une atteinte à la paix civile.
Dans le monde musulman contemporain, la plus grande réussite des extrémistes religieux a été de déplacer cette règle essentielle. La liberté de penser, de questionner et de chercher, lorsqu’il s’agit de l’héritage religieux, a été extrêmement restreinte. Par contre, la possibilité de subvertir les esprits, de semer la discorde et la subversion, a été renforcée. Les extrémistes ont réussi à pervertir les limites du tolérable et de l’intolérable. Dans les années 1920 et 1930, il a été possible à des chercheurs et des penseurs musulmans de s’exprimer librement sur des questions ayant trait à la religion et à sa présence dans l’ordre social et politique. Certes, leurs écrits avaient été dénoncés par des conservateurs et des extrémistes, qui ont cherché à déclencher des troubles sur la place publique. Ces tentatives n’ont toutefois pas eu le succès que leurs auteurs attendaient. Elles n’ont pas soulevé les masses. Par contre, certains gouvernements de l’époque, tenus par des élites politiques conservatrices, ont été rapides à profiter de ces dénonciations pour restreindre les libertés de penser et de publier. Ce sont des gouvernements conservateurs (ou despotiques), peu enclins à accepter l’émancipation des esprits, qui ont «décelé» dans la liberté de penser un danger potentiel pour la paix publique. Les extrémistes ont donc réussi à rallier les gouvernements à leur cause, et à imposer une forme de censure on ne peut plus pernicieuse : la pensée rationnelle, la recherche scientifique qui, en elles-mêmes, ne représentent aucun danger pour l’ordre public, ont depuis lors été considérées comme subversives.
Le discours de l’ignorance a pignon sur rue, celui du savoir est réprimé
Il en résulte que, aujourd’hui, les libertés dont jouissaient les penseurs et les chercheurs il y a soixante-dix ou quatre-vingt ans paraissent comme un rêve. Par contre, les discours enflammés, souvent basés sur des conceptions intenables (scientifiquement) et indéfendables (moralement), sont disséminés, voire imposés en toute liberté. Le discours de l’ignorance a pignon sur rue, celui du savoir a été réprimé.
De nombreuses élites politiques ont considéré ce revirement comme une forme de prudence élémentaire, une protection convenable pour leurs positions et leurs intérêts. Elles se sont embarquées dans des politiques qui restreignaient la liberté des discours rationnels et critiques. Elles ont laissé libre cours à ceux qui, fondés sur l’ignorance et la passion aveugle, favorisent l’embrigadement massif de ceux qui n’ont pas accès aux productions intellectuelles et artistiques modernes, c’est-à-dire la majorité des populations. Ils espéraient «acheter» ainsi la complaisance, voire la complicité, des milieux conservateurs et extrémistes et, peut-être, différer le moment où les comptes doivent être rendus, où le pouvoir doit être soumis aux normes de la gouvernance moderne. C’est d’avoir ignoré les différences essentielles entre la vraie liberté de penser et la liberté d’enflammer les esprits, c’est d’avoir fait des calculs à court terme, que l’on s’est trouvé progressivement désarmé face aux discours fondés sur l’ignorance
A suivre…(*) Directeur de l’Institut d’études des civilisations musulmanes. Université Aga Khan, Londres.
NB : ce texte est la deuxième partie d’un point de vue dont la suite paraîtra dans nos trois prochaines éditions.
