Idées
Les enjeux de la libéralisation des services
Si la libéralisation doit être compatible avec les règles fixées par l’OMC, elle doit aussi être envisagée dans une perspective de co-développement entre le Maroc et l’Union européenne.
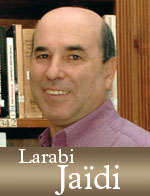
Le Maroc et l’Union européenne ont démarré les négociations en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA). Il est destiné à approfondir les relations d’échanges existantes dans les domaines qui ne sont pas encore couverts, tels les services et les marchés publics, d’alléger les barrières commerciales liées aux normes et de mieux protéger les investissements, et d’établir de nouveaux engagements en matière de concurrence et de droits de propriété. Dans ce menu étendu, la question de la libéralisation des services est un enjeu primordial. Il est vrai que les services représentent 39% du PIB du Maroc et 23% des recettes de son compte.
La question de la libéralisation des services s’annonce plus complexe que celle des biens : la fourniture est généralement peu transfrontalière et implique la proximité du fournisseur et du client et le déplacement des personnes ; les imperfections de marché sont nombreuses et il est difficile de mettre en place des régulations concurrentielles. De plus, l’hétérogénéité des services rend difficile l’adoption d’un cadre commun.
En fait, les rounds bilatéraux de négociations entre l’Union européenne et le Maroc sur le secteur des services ont été lancés en février 2008. Les négociations ont porté sur la réduction de deux types de limitations concernant l’accès aux marchés et au traitement national. Contrairement à l’approche de liste négative adoptée lors des négociations de l’Accord de libre-échange avec les États-Unis, la préparation des listes de concessions dans le cadre des négociations avec l’Union européenne devait se faire selon une approche de liste positive. L’approche de liste positive implique que les listes d’offre de concessions de chaque partie indiqueront les engagements spécifiques par secteur et par mode de fourniture des services où sont inscrites les limitations. Par ailleurs, le projet de protocole relatif à la libéralisation du commerce des services et de l’établissement entre l’UE et le Maroc mentionne d’autres principes de négociations au sujet desquels le Maroc a présenté des réserves. Il s’agit, d’une part, de la clause générale de la Nation la plus favorisée (NPF générale). Du point de vue de la Commission européenne, cette clause signifie que l’UE ne peut pas avoir, de la part de ses partenaires méditerranéens, un traitement moins favorable que celui accordé par ces pays à leurs principaux concurrents. Le Maroc a considéré que cette clause risquait de compromettre le processus des négociations, parce qu’elle reprend à elle seule des concessions accordées de fait à l’UE avant même le démarrage des négociations.
D’un autre côté, le protocole mentionne la notion de la clause régionale de la Nation la plus favorisée (NPF régionale). Cette clause stipule que si les pays méditerranéens décident d’ouvrir des négociations entre eux, ils s’accorderont, en général, mutuellement, des avantages égaux ou meilleurs que ceux accordés à l’UE. Dans l’esprit de la Commission européenne, cette clause est motivée par la volonté d’inciter à l’intégration régionale Sud-Sud. Le Maroc a fait valoir qu’au contraire cette clause pourrait décourager les partenaires méditerranéens de se lancer dans des négociations par le fait même qu’elle implique pour ces pays de s’accorder mutuellement, et immédiatement, les mêmes concessions accordées à l’UE.
Valeur d’aujourd’hui, l’offre marocaine n’a pas encore été finalisée. La relance des négociations dans le cadre de l’ALECA impose de progresser dans ce domaine. D’aucuns pensent que les secteurs des services au Maroc sont supposés bénéficier d’une protection plus élevée que ceux de l’UE, la libéralisation des services devra par conséquent ouvrir plus d’opportunités pour les industries de services européens au Maroc que dans le sens inverse. Mais, on peut tout autant supposer que l’amélioration des services, notamment ceux liés au commerce (transport, finance, réseaux et télécommunications, énergie), permettrait de diminuer sensiblement les coûts des transactions, conduirait à une augmentation des entrées d’IDE et des investissements domestiques et aurait des effets sur la croissance du produit intérieur. L’essentiel est que le Maroc s’engage dans la libéralisation des services en tenant compte d’un certain nombre de principes : l’importance du secteur pour le pays (apports, externalités possibles), la sécurité des transactions et des procédures (marchés publics), les effets sur l’emploi et l’effet d’entraînement sur les autres secteurs, la sensibilité à la souveraineté de la décision (énergie, finance) et à l’identité (biens culturels). Les services de l’énergie et la mise en place de réseaux interrégionaux par interconnexions sont déterminants pour l’efficacité et la sécurité de l’approvisionnement national. Pour les services ordinaires (services postaux, services informatiques et de conseil, la distribution et les professions indépendantes), l’ouverture doit tenir compte des effets sur les prix et l’emploi. Quant aux services sociétaux, services publics, services culturels, éducation, services à la personne, la perspective est de développer l’échange d’expérience, les meilleures pratiques, la reconnaissance des qualifications et l’assistance technique. Les deux partenaires estiment que la libéralisation des services doit être adaptée à la situation particulière de chaque sous-secteur, afin de ménager les transitions nécessaires. Si elle doit être compatible avec les règles fixées par l’OMC, elle doit aussi être envisagée dans une perspective de co-développement entre le Maroc et l’Union européenne.

