Idées
La société marocaine, une « société de défiance » ?
Le modèle social marocain serait pris dans un cercle vicieux, la défiance induisant une perte de crédibilité de la compétition, favorisant la corruption et entretenant des rentes qui empêcheraient les réformes sociales, utiles à la population, de voir le jour.
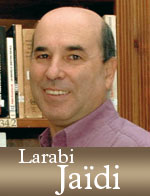
«Aie confiance», susurre le perfide serpent Kaa dans la célèbre adaptation du Livre de la jungle en dessins animés. Un refrain qui n’est pas près d’envoûter les jeunes à l’heure où ils semblent toujours plus nombreux à douter du Parlement (60%), des collectivités locales (74%) ou du gouvernement (51%). Une étude, menée par le HCP et dévoilée cette semaine, tente de sonder la profondeur de cet abîme de défiance. La confiance est constamment convoquée dans le débat public. Hier, encore un autre sondage du HCP révélait une baisse de confiance des consommateurs. Avant-hier, le chef du gouvernement en personne évoquait la nécessité d’établir la confiance entre les institutions du pays, entre la société et son personnel politique pour gagner la bataille de la réforme et du progrès social. Ces exemples offrent une illustration de la nébuleuse omniprésente de la question de la confiance dans notre économie et notre société. C’est à croire que la confiance est une valeur qui n’est pas ou peu répandue dans notre société.
En dépit de ses fréquents usages, la notion de confiance soulève immédiatement le problème de son contenu : est-ce un phénomène micro-social ou macro-social ? Est-ce un sentiment, une vertu individuelle ? Une relation interpersonnelle, une attente sociale ? Dans les sondages, les personnes enquêtées font usage de leur sens commun de la confiance, qui peut beaucoup varier, les interprétations des résultats risquent d’être dépendants de la subjectivité, variable dans l’espace et le temps, d’individus dont on ne recueille que l’opinion au sujet d’une question dont la précision et la signification mêmes sont contestables. La fragilité du concept de confiance fait qu’il est assez difficile de savoir ce que recouvre exactement cette notion, dont l’usage plastique paraît masquer une grande confusion. Pour les uns, la confiance est le produit d’une relation inter-personnelle qui s’appuie sur un calcul reposant in fine sur l’intérêt individuel ; pour les autres, la confiance est un acte culturel et social reposant sur des traits institutionnels de la société.
Dans sa forme la plus restreinte la relation de confiance interpersonnelle est la marque des sociétés traditionnelles, elle se limite aux liens du sang puis de la tribu, du clan, du groupe, de la communauté. La marche d’une société vers la modernité supposerait l’édification d’institutions qui permettent justement de se dispenser de la confiance interpersonnelle. La véritable question posée à notre société serait donc celle de la qualité (d’équité et/ou d’efficacité) des institutions substituées aux rapports interpersonnels de confiance. Si le Maroc se distinguerait par un niveau élevé et persistant de défiance, la cause de ce mal serait institutionnelle : il faudrait la rechercher dans ce mélange de corporatisme, de clientélisme et d’étatisme du «modèle social» marocain institué depuis une longue date, qui, du fait de sa nature hybride, donnerait lieu à un fort sentiment d’injustice, à un «dialogue social» réduit à la portion congrue et à des déviances dans les interventions de l’Etat. Celles-ci, loin d’apaiser la méfiance des Marocains les uns envers les autres et envers leurs institutions, l’aggraveraient au contraire. Au total, le modèle social marocain serait pris dans un cercle vicieux, la défiance induisant une perte de crédibilité de la compétition, favorisant la corruption et entretenant des rentes qui empêcheraient les réformes sociales utiles à la population de voir le jour.
Le coût économique et social de cette «défiance» s’avérerait considérable, le déficit de confiance réduisant significativement et durablement l’effort, la croyance en la valeur travail et en conséquence l’emploi et le revenu par habitant ; le modèle social risquerait à terme d’éroder inexorablement la capacité des Marocains à vivre heureux ensemble. Si la confiance interpersonnelle apparaît nécessaire au développement économique, celui-ci tend à se mettre en œuvre et à se poursuivre en donnant une place croissante à la confiance institutionnelle au détriment de la confiance interindividuelle. La qualité des institutions joue un rôle majeur dans la démocratie. Elle suppose d’accorder sa confiance, non pas aux personnes qui l’incarnent, mais bien au contraire à l’idée normative qui guide l’action de l’institution et aux sanctions attachées au respect de la norme collective par les représentants de l’institution. Tout le problème de notre société réside dans une question centrale : comment relier la confiance dans les institutions à la confiance interpersonnelle ; comment établir cette correspondance entre, d’un côté, les idéaux normatifs que les personnes prétendent honorer (justice, objectivité, égalité), les standards de comportement dont elles se réclament ; de l’autre leurs conduites et leurs prestations.
Même si aucune unité de mesure vraiment fiable n’existe à l’heure actuelle, la valeur sociale de la confiance ne fait pas de doute. Elle est censée procurer toutes sortes de bienfaits économiques et démocratiques, surtout aux sociétés qui n’en disposent pas en abondance. C’est dans ce sens que le débat sur sa fragilité, la fiabilité de sa mesure mérite d’être poursuivi. Car la confiance est une denrée précieuse, elle se signale par son absence et demeurerait insaisissable quand elle existe.

