Au Royaume
Le dictat des intermédiaires
Les données dévoilées cette semaine par le ministère de l’intérieur au sujet de la culture du cannabis et de tout l’écosystème qui gravite autour sont édifiantes.
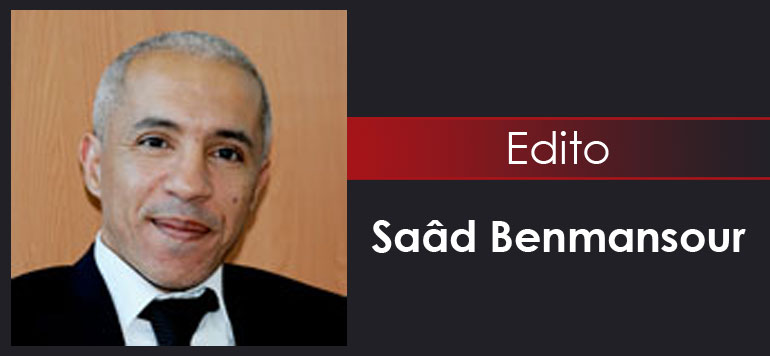
Les études et analyses présentées aux parlementaires, entre autres publics cibles indiquent suffisamment la pertinence d’une démarche progressive de légalisation. C’est ce que le législateur et l’administration tentent aujourd’hui de présenter et défendre.
Mais ce qui est sûr c’est que certains chiffres parlent d’eux-mêmes, confirment et confortent ce qui était déjà largement démontré, à savoir que les gains et les bénéfices générés par cette industrie du cannabis au Maroc ne profitent finalement que très peu aux producteurs qui sont dans leur grande majorité, si ce n’est tous, que de simples petits agriculteurs aidés par les membres de leurs familles. Quelques chiffres suffisent pour s’en convaincre. Ainsi, on apprend que 80% des parcelles cultivées par les quelque 60 000 familles sont d’une superficie inférieure à 1,25 hectare. Ensuite, et c’est le plus frappant, il a été établi que la culture du cannabis procure à ces petits producteurs un revenu global estimé à 325 millions d’euros au moment où la valeur marchande de leur production sur le marché de la consommation finale, le plus souvent en Europe, est estimée à 12 milliards d’euros, soit un effet multiplicateur de presque 37 fois. Ce sont finalement plus les intermédiaires et autres réseaux mafieux qui tirent profit du trafic illégal du cannabis.
Mais il n’y a pas que dans ce cas précis que les circuits d’intermédiation posent problème. Même dans des secteurs d’activités «normaux» et «légaux», la problématique et ses retombées négatives sont depuis longtemps connues et identifiées par les pouvoirs publics. Quand on compare les écarts entre les prix de certaines denrées alimentaires ou agricoles au départ de leur lieu de production et les prix auxquels ils sont vendus dans le commerce de détail, le constat est vite fait : les différences dépassent et de loin des niveaux de marges normaux qui pourraient s’expliquer par des coûts réels comme le transport, le traitement, l’entreposage et autres activités économiques saines pouvant justifier un bénéfice pour l’opérateur. D’où d’ailleurs le lancement depuis quelques années d’une réforme des circuits des marchés de gros dont la modernisation forcée commence à donner ses fruits.
Pour autant, l’intermédiation au sens général est une activité économique à part entière, nécessaire et naturelle. Ce qui cause le plus de tort c’est plutôt la désorganisation, le manque d’encadrement, y compris légal et réglementaire, le faible niveau de professionnalisation ou encore quand l’intermédiation devient synonyme d’anarchie, de spéculation, voire de rentes…

