Affaires
Zones industrielles : le difficile équilibre entre l’offre et la demande
En dehors de l’axe Casablanca-Rabat-Kénitra ainsi que de Tanger, la plupart des zones sont loin de faire le plein, faute d’attractivité régionale. Grâce à quelques garde-fous, la spéculation pose moins de problèmes qu’auparavant. L’agence MCA Morocco s’apprête à lancer un nouveau fonds pour des zones industrielles durables.

Un appel d’offres, annonçant onze futures zones industrielles dans les régions, n’est-il pas suffisant pour susciter des questionnements quant à la pertinence de la stratégie nationale en la matière ? En d’autres termes, a-t-on pensé à corriger le tir avant de se lancer dans de nouvelles aventures ? Surtout que plusieurs expériences ont été décevantes.
D’emblée, la question de l’adaptation de l’offre et de la demande, dans les quatre-vingt ZI existantes à travers le pays, est soulevée comme étant le prérequis essentiel de réussite. Si les expériences concluantes existent, à l’image de celle de l’AZIT à Tanger (voir encadré), certaines zones, comme celles d’Aït Melloul (354 ha), Sidi Bouâthmane (107 ha), Asilah ou Larache, sont loin d’être un exemple de parfaite adaptation de l’offre et de la demande. Donc de réussite. Pire, le constat global est que, dernièrement, l’Etat a ouvert des zones industrielles sans que cela ne soit motivé par l’existence d’une demande, évaluée et précisée en amont.
L’issue de ces onze nouveaux projets est-il donc aussi facile à prévoir ? Nous ne pouvons malheureusement qu’extrapoler: nos questions envoyées à Ouatiqua El Khalfi, directrice des infrastructures au ministère du commerce et de l’industrie, étant restées sans réponse. En tout cas, les professionnels sont du même avis. «Effectivement, si dans les ZI l’offre ne répond pas à la demande, le taux de réussite sera sans doute très bas», commente Mounir Benyahia, président du Collectif des zones industrielles pour l’environnement (COZINE). Que faire donc? «Les zones doivent constituer des pôles d’intérêt pour les industries locales. Il faut attirer des investissements tournés vers le marché national», abonde Adil Rais, président de l’Association des zones industrielles de Tanger (AZIT), confirmant les propos de M. Benyahia. L’expérience de l’AZIT peut-elle donc être un bon benchmark? En tout cas, elle présente la parfaite illustration d’un projet rassemblant plusieurs éléments clés d’une zone industrielle. «Les projets dans les villes dotées d’infrastructures, de main-d’œuvre et surtout de vision peuvent facilement attirer des investisseurs», poursuit M. Rais.
Reste donc la question de la gestion des services, tout aussi cruciale pour séduire des entreprises et atteindre un taux de satisfaction élevé. Mais, dans le cas de la ZI Sidi Bernoussi-Sidi Moumen, leur absence n’a jamais induit l’effet inverse, à savoir la baisse de la demande, grâce à l’emplacement de la ZI, en plein milieu de la capitale économique.
Demande très élevée à Bernoussi-Sidi Moumen
Le parallèle entre l’axe Casablanca-Rabat et les régions est édifiant pour illustrer la problématique de l’offre et de la demande. Entre les deux capitales administrative et économique du Royaume où le foncier se raréfie, la demande est tellement forte qu’il n’y a pratiquement pas de points communs avec les régions, hormis quelques exceptions. A la zone industrielle Sidi Bernoussi-Sidi Moumen qui regroupe 575 opérateurs, la demande demeure très élevée, en dépit du manque d’infrastructures, de transport collectif, de services mutualisés et du guichet unique. Ces avantages sont, selon Fatima Zahra Khairat, directrice de l’Association Izdihar qui gère cette ZI, en collaboration avec les autorités, ce qui manque le plus à cette zone. En tout cas, le positionnement géographique de cette zone industrielle, au milieu de Casablanca, attire en permanence des opérateurs, ce qui fait que les départs sont très rapidement comblés.
La demande dans ce cas précis s’explique ainsi par un avantage concurrentiel de taille, à savoir celui de l’emplacement, entraînant évidemment la disponibilité des ressources humaines. «Malgré les problématiques citées, la zone demeure très attractive. Nous sommes situés à proximité du port de Casablanca, de Mohammédia et même de Rabat. L’accès à l’autoroute n’est pas loin également, sans compter la main-d’œuvre disponible. Cela résume les atouts de notre zone», précise Mme Khairat.
Le dimensionnement, l’autre équation à résoudre
L’enjeu de la mise en place d’une zone industrielle dans une région reste indéniable. Apport en termes de recettes fiscales, emploi, attractivité, investissements : les atouts ne manquent pas. «Encore faut-il que la programmation et le dimensionnement des zones soient efficaces. Si une ZI doit suivre un rythme d’évolution dictée par la demande et avoir des atouts stratégiques, comme une locomotive ou un raisonnement économique solide, la définition de la taille, des superficies des lots et bâtiments et les services demeure primordiale», précise M. Benyahia. A l’heure actuelle, le foncier ne détermine plus, à lui seul, le dimensionnement d’une zone, de ses lots et des caractéristiques de ses bâtiments. Depuis quelques années, la stratégie des écosystèmes industriels a été introduite, non sans succès. Les fédérations industrielles impliquées, les superficies ainsi que la taille des lots, à mettre à disposition des industriels, correspondent de plus en plus aux attentes des opérateurs.
Mais d’aucuns jugent les prix parfois élevés. Il suffit de comparer, dans certaines ZI, les prix de commercialisation de départ et les prix actuels pour se rendre compte de l’ampleur de ce phénomène.
A Aït Melloul, le prix actuel du m2 peut aller jusqu’à 1500 DH, alors qu’il ne dépassait pas 240 DH au lancement (www.lavieeco.ma). Selon Mounir Benyahia, ce problème de la spéculation sera dépassé dans le futur. En effet, plusieurs mesures ont permis de dissuader les spéculateurs. Les prix bas appliqués grâce aux subventions de l’Etat avaient souvent tendance à attirer les spéculateurs de tout bord. Le remède à cette situation était d’appliquer des «garde-fous», comme la constitution de commissions d’attribution, qui se sont avérées efficaces. Ces structures ont comme rôle de s’assurer du bien-fondé des business plans des futurs projets de ZI.
Une autre mesure, appliquée en l’occurrence à la zone industrielle bâtie par Al Omrane à Mohammédia, consiste à obliger les acquéreurs de lots, par le biais d’une inscription hypothécaire, à valoriser leur bien, commencer l’activité, avant de pouvoir le céder, une fois la mainlevée accordée. Une technique qui a donné ses fruits, «bien qu’elle soit juridiquement complexe et difficile à appliquer», commente Mounir Benyahia, qui occupe également le poste de directeur général des parcs industriels de la CFCIM. Au sein de cette dernière, le choix a été porté sur le locatif, justement, «pour résoudre ce problème de la spéculation».
En tout cas, il y a du nouveau dans le secteur. Actuellement l’Agence Millenium Challenge Maroc s’apprête à lancer le nouveau Fonds des zones industrielles durables (ZID), destiné à appuyer les zones industrielles. Pour ce faire, il sera créé un centre d’expertise pour accompagner le programme gouvernemental en matière de zones industrielles, notamment en ce qui concerne le choix des sites et de l’évaluation de la demande en amont. A l’heure où nous mettions sous presse, les détails promis par Ayoub Eddaira, directeur du centre d’expertise de l’agence, ne nous sont pas parvenus.

L’AZIT, un cas d’école
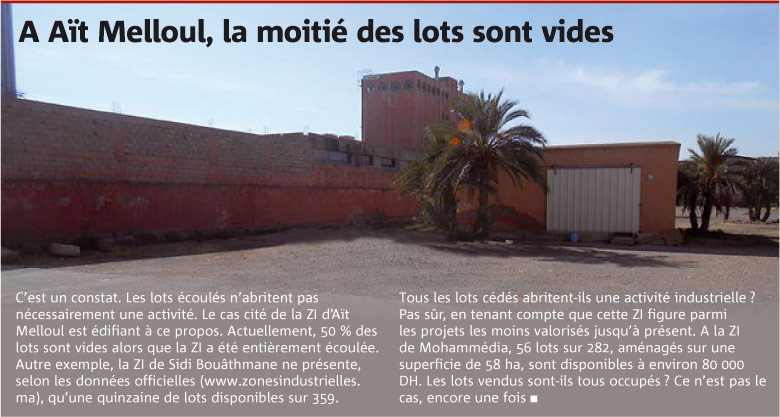
A Aït Melloul, la moitié des lots sont vides

