Affaires
La réglementation des délais de paiement arrive
Un texte préparé par la Commission nationale de l’environnement des affaires a été remis pour avis à la CGEM qui doit se prononcer à la rentrée.
Deux détails en suspens : le délai à fixer et les taux pour le calcul des intérêts de retard.
Les pouvoirs publics veulent une norme opérationnelle pour fin 2010.
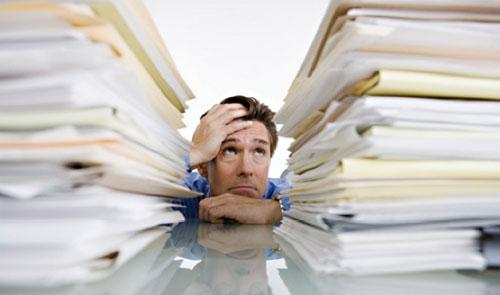
Le problème des délais de paiement qui empoisonne le monde des affaires depuis plusieurs années va probablement trouver une solution légale, seule issue à même de garantir que les entreprises ne soient pas asphyxiées par le poids des créances qu’elles n’arrivent pas à recouvrer auprès de clients avec lesquels elle craignent la plupart du temps d’être en délicatesse. Le chantier a été ouvert par les pouvoirs publics, dans le cadre de la Commission nationale de l’environnement des affaires, créée dans la foulée de la mise en œuvre du Pacte national pour l’émergence industrielle(*).
Une première mouture d’un projet de texte réglementant les délais de paiement, confectionnée par l’industrie et le commerce, est aujourd’hui en examen chez le patronat et plus précisément au sein de la Commission PME. Auprès de cette dernière, c’est la prudence qui prévaut. Pour Saâd Hammoumi, le vice-président de ladite commission, contacté par La Vie éco à ce sujet, il n’y a pas encore lieu de parler ni d’avant-projet de texte ni de mouture mais simplement d’une réflexion, avancée certes, mais toujours en cours. M. Hammoumi indique, à ce titre, que «la question a encore besoin d’être débattue par les instances et les membres de la CGEM».
Compte client : 120 jours du chiffre d’affaires actuellement
Pourtant du côté de l’administration, le ton est plus optimiste. Plusieurs sources concordantes au sein de la Commission nationale de l’environnement des affaires confirment l’existence d’un texte, presque finalisé à l’exception de deux détails qui restent à fixer. Et c’est justement dans ces deux détails que réside toute l’essence du texte. Il s’agit notamment du délai maximal de règlement des transactions commerciales et du mode de calcul des intérêts moratoires à appliquer en cas de retard.
Pour ce qui est de la question centrale du délai, il faut le dire, le débat est loin d’être clos et va certainement être houleux chez le secteur privé. «Ce n’est pas à l’administration de prendre une décision dans ce sens mais aux entreprises elles-mêmes», explique un haut fonctionnaire estimant, à juste titre, que «les chefs d’entreprises sont les mieux placés pour cela». Et c’est la raison pour laquelle, au moment de remettre la proposition à la CGEM, les représentants de l’administration lui ont laissé du temps pour trancher. Cependant, déjà, de premières pistes semblent se dessiner. L’on sait par exemple qu’une marge de retard sera tolérée sans donner lieu à sanctions. L’on sait également que le délai ne pourra certainement pas être uniforme mais en fonction de la nature des secteurs.
Maintenant, c’est la question fondamentale qui reste à résoudre : quel délai prévoir ? 30, 45, 60 jours ? Pour l’instant aucune réponse concrète n’est encore disponible si ce n’est que ce délai de paiement doit être raisonnable et, évidemment, inférieur à ce qui se pratique aujourd’hui. La réponse définitive à cette question devrait justement être fournie au terme de l’étude réalisée aujourd’hui par la CGEM. Une étude confiée à la Commission PME qui doit rendre sa copie au plus tard en septembre prochain. Une chose est sûre, toutefois, «l’objet de ce texte est de réduire les délais de paiement trop lents qui sont observés aujourd’hui dans le secteur privé». Selon des estimations faites par la CGEM au mois de mars dernier, le compte client représente aujourd’hui 120 à 180 jours de chiffre d’affaires des entreprises et peut atteindre, parfois, jusqu’à 50% du total bilan. Du coup, explique-t-on auprès de la confédération, «les capacités financières des entreprises sont accaparées par le financement du fonds de roulement au détriment de l’investissement, ce qui met en danger la compétitivité des entreprises et plus particulièrement les PME».
La liberté contractuelle sacrifiée au profit de l’intérêt collectif
Le deuxième volet qui reste encore à peaufiner est celui des sanctions. Intérêts moratoires, sanctions pénales…, là aussi, toutes les options sont encore au stade de réflexion notamment la formule et le taux qui serviront de base au calcul des dommages. Mais l’on peut d’ores et déjà deviner que les rédacteurs du texte s’inspireront à coup sûr de ce qui se fait déjà en matière de marchés publics pour lesquels les retards de paiement donnent lieu à des moratoires calculés sur la base d’un taux fixé chaque trimestre par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) lui-même indexé sur le taux moyen pondéré des bons du Trésor à 13 semaines.
Pourtant, s’il est vrai que la réglementation des délais de paiement est une nécessité, il n’en demeure pas moins qu’elle pose un problème d’ordre juridique. En matière de droit des affaires, il est en effet connu que le contrat est la loi des cocontractants. En d’autres termes, deux partenaires, un client et un fournisseur en l’occurrence, sont en principe libres de convenir du délai de paiement qu’ils souhaitent pourvu qu’il y ait consentement mutuel. Se pose alors le problème suivant : si, demain, la loi fixe le délai à 60 jours, qu’en est-il d’un contrat où les parties conviennent d’un délai supérieur ? Epineuse question ? Pas sûr car du côté de l’administration, il est expliqué sans ambages que «les délais qui seront fixés dans le futur texte seront obligatoires et opposables à tous, bien entendu selon les spécificités sectorielles qui seront fixées». Quid de la liberté contractuelle alors ? Pour ce haut fonctionnaire et juriste, l’argumentaire coule de source : «Très souvent, dans le milieu des affaires, les rapports de force font que les fournisseurs, souvent des PME, n’ont d’autres choix que d’accepter les conditions de leurs clients surtout quand il s’agit de grandes entreprises». Du coup, pour ce juriste, il s’agit de contrats d’adhésion avec un consentement de façade de la part des PME. «C’est là que réside la vraie finalité de ce texte, à savoir rééquilibrer ces rapports de force et donner aux PME un cadre légal pour les protéger contre l’abus de gros clients». Sur le même registre juridique, le texte réglera aussi un grand problème, celui des dommages et intérêts dus en cas de retard de paiement. Aujourd’hui, quand un litige commercial entre deux partenaires est porté devant un tribunal, le montant de l’indemnisation est laissé à l’appréciation des magistrats qui ne sont pas toujours outillés pour une telle expertise. La loi sur les délais de paiement veut donc réduire cette marge d’appréciation des juges en détaillant les sanctions en cas de retard et en clarifiant leurs modalités de calcul.
Reste alors une dernière question : les grandes entreprises, membres de la CGEM, accepteront-elles de telles contraintes ? En tout cas, au sein de la CGEM, on sent que la question suscite beaucoup de susceptibilités et c’est la raison pour laquelle d’ailleurs le débat est engagé mais de manière très prudente. Cela dit, le compte à rebours, lui, est déjà entamé. A la fin du mois de septembre, la commission doit rendre sa copie et elle le fera, là aussi, avec beaucoup de diplomatie dans le cadre d’un colloque placé sous le thème «Réduction des délais de paiement : levier de croissance». La rencontre, dit-on à la CGEM, a pour objectif de présenter la problématique et sensibiliser l’ensemble des acteurs. Mais ce sera peut-être le meilleur moyen de faire passer la pilule n
(*) Elle est constituée d’un groupe de travail comprenant les ministères de l’industrie et du commerce, des affaires générales, de l’économie et des finances, de la justice, du CDVM et de la Commission PME de la CGEM.

