Affaires
La loi sur les délais de paiement changera-t-elle les mauvaises pratiques commerciales ?
60 jours maximum pour payer une créance, 90 jours en cas d’accord mutuel et une amende en cas de retard. Les opérateurs craignent que l’application stricte du texte n’impacte leurs relations commerciales. L’invocation de la Loi plutôt considérée comme ultime recours en cas d’impayé.
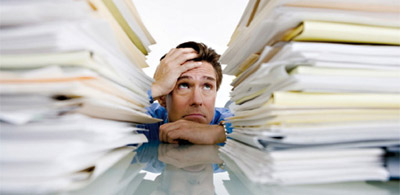
Les relations commerciales devraient être mieux organisées d’ici quelques semaines. Attendu depuis plusieurs mois, le texte (projet de loi 32-10) sur les délais de paiement avec l’adoption complétant la loi 15-95 relative au code du commerce est sorti du Parlement, le 5 juillet, après son adoption par les deux Chambres. Sa publication au Bulletin officiel ne devrait pas tarder.
Jusque-là, aucun texte légal n’évoquait clairement la question des délais de paiement entre opérateurs privés. Seule la loi 06-99 sur les prix et la concurrence interdit de pratiquer des délais de paiement discriminatoires et non justifiés à l’égard d’un partenaire économique.
Or, l’allongement des délais de paiement n’épargne aucun secteur, et les répercussions sont néfastes sur l’économie. Comme le signale le ministère du commerce et de l’industrie, «le non-paiement des créances dans des délais raisonnables constitue l’une des principales difficultés de l’entreprise, en particulier les petites et moyennes structures».
Les délais de paiement doivent figurer dans les états des sociétés dont les comptes sont certifiés
La Loi 32-10 entend corriger ces anomalies. Dorénavant et dans le cas où le contrat de la transaction entre les deux parties n’y fait aucune référence, le délai de paiement des créances ne doit plus dépasser les 60 jours à compter de la date de réception de la marchandise ou de la réalisation du service. Si les deux parties se mettent d’accord sur un délai de paiement, il ne doit excéder les 90 jours. Le fait de fixer un seuil maximum de jours est aussi d’une grande importance, estiment les responsables de plusieurs organisations professionnelles. Car pour la première fois, le législateur s’attaquera à une pratique très courante dans le domaine du commerce, à savoir les facilités de paiement auxquelles recourent nombre d’entrepreneurs. Celles-ci «deviennent parfois un facteur de concurrence déloyale», explique le président d’une association professionnelle.
Pour tout retard, la loi prévoit une amende dont la valeur sera fixée par un texte d’application. Initialement, le législateur avait proposé un taux d’intérêt sur la valeur de la créance, dont le montant ne doit pas être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib plus une marge. Un amendement présenté par les députés a remplacé le taux d’intérêt par une amende. Celle-ci s’appliquera à partir du premier jour qui suit le délai autorisé (60 ou 90 jours). Pour éviter toute tentative d’entente entre les partenaires commerciaux, la loi annule toute disposition du contrat où le commerçant renonce au droit de revendiquer des amendes sur le retard de paiement. Autre nouveauté : les sociétés tenues de certifier leurs comptes annuels doivent y inclure leurs données relatives aux délais de paiement. Les modalités seront détaillées dans des textes d’application. En principe, un tel dispositif doit être bien accueilli, surtout par les petites structures, mais ceux qui ont soutenu le texte risquent d’être déçus. «Beaucoup de commerçants vont rechigner à l’application de ces dispositions en avançant les mêmes arguments comme la lenteur des cycles de ventes dans notre secteur», souligne David Toledano, président de la Fédération marocaine des matériaux de construction (FMC).
Ce sont les rapports de force qui continueront à régir les délais
Mais si les entreprises créancières hésiteront à faire respecter le texte au début, c’est essentiellement en raison de la crainte des représailles. «Je ne peux pas me mettre sur le dos mes partenaires», confie un chef de PME. On voit mal, en effet, une PME demander avec insistance à une grande surface ou un client majeur d’honorer ses engagements dans les délais. Cette attitude prévaut déjà avec l’Etat dont les rapports commerciaux avec ses prestataires ont été réglementés bien avant. Comme l’a reconnu le ministre du commerce et de l’industrie, lors du débat au sein de la commission parlementaire sur ce projet de loi : «En dépit de l’existence d’une loi qui fixe le délai pour l’Etat à 60 jours, les sociétés n’osent pas lui demander de payer des pénalités». De fait, c’est plus le rapport de force et le degré de dépendance vis-à-vis du client qui continuera à régir les délais de paiement.
Et le recours à la justice n’est pas facile non plus. Hormis le risque de la dégradation de la relation commerciale, le facteur temps joue également. «Le recours à la justice est très coûteux et prend beaucoup de temps», souligne Hammad Kessal, entrepreneur et ancien président de la Fédération des PME-PMI à la CGEM. De fait, et comme le résume un autre chef d’entreprise, «la justice sera le recours ultime mais non optimal». En clair, on s’adressera à la justice en cas d’impayés et on fera alors valoir les dommages dus selon le nouveau texte sur les délais de paiement.
Il faut s’attendre donc au développement de certaines pratiques qui viseraient à contourner la loi pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec celle-ci : le changement de la date des factures, par exemple, indique un chef d’entreprise.
Il reste que l’apport d’une telle réglementation est un élément très positif, même si ses effets ne seront pas perceptibles dans l’immédiat. Elle induira nécessairement un changement des mentalités. «Il faut une période d’adaptation et tout le monde s’y mettra par la suite», affirme Bouchaib Benhamida, président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP). Cette loi «permettra de mettre de l’ordre dans le monde des affaires et de consolider un système de paiement selon des normes plus strictes et raisonnables», commente M. Toledano. Même constat de la part de Jamal Bahhar, DG de la Fédération des industries du cuir (FEDIC), pour qui «cette réglementation donnera plus de fluidité aux transactions commerciales et à l’économie».
Mais, d’ici là, le gouvernement a un rôle déterminant à jouer : la communication. Car, jusqu’à présent, la plupart des entrepreneurs et des commerçants ignorent tout d’un texte qui entrera en vigueur sous peu. «L’adoption de la loi est passée inaperçue et aucune action de sensibilisation n’a été entreprise autour de cette réglementation», déplore Moncef El Kettani, président de l’Union générale des entreprises et professions (UGEP).

