Idées
Comment construit-on les prévisions de croissance ?
Les prévisions économiques sont un exercice délicat qui a ses règles, ses hypothèses et ses méthodes. Dans cet exercice, le rôle que présente le monitoring de la conjoncture dans la prévision macroéconomique est fondamental.
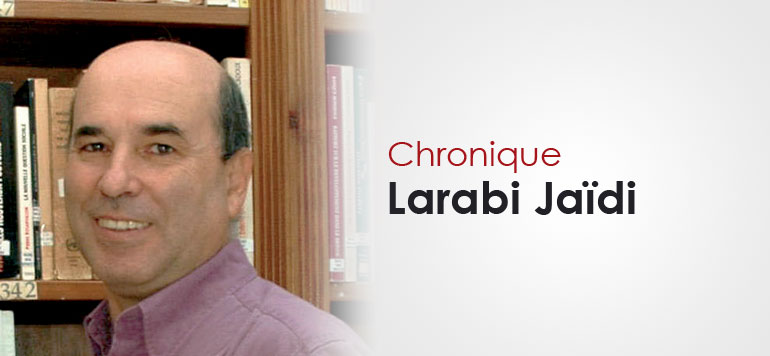
I va falloir repenser la prévision de croissance fixée par le gouvernement, laisse entendre à juste titre le Haut commissariat au plan. Le budget a été construit sur une hypothèse de croissance de 3%. L’évolution récente de la conjoncture agricole remet en cause les premières estimations. Comment prévoit-on la croissance ? Gouvernement, organismes publics, centres de recherches, institutions internationales…, nombreux sont ceux qui essayent de prévoir l’activité économique nationale avec des moyens différents. Il existe de nombreuses méthodes, plus ou moins rigoureuses, pour prédire la croissance, d’où les écarts fréquents entre les prévisions des différents organismes qui s’essayent à l’exercice.
Le HCP établit ses prévisions économiques à court terme sous deux formes et en deux temps. Une première élaboration en mars-juillet de perspectives économiques exploratoires cohérentes pour l’année suivante sur la base d’hypothèses concernant les variables exogènes, à politique budgétaire inchangée. Au dernier trimestre de l’année finissante ou au premier mois de l’année entamée, la version exploratoire est actualisée sur la base d’informations économiques de conjoncture plus fraîches. Les prévisions des principaux agrégats macroéconomiques tiennent compte des actions et des mesures retenues dans la Loi de finances adoptée par le Parlement. Les conjoncturistes du HCP font usage des méthodes de modélisation pour formaliser les fluctuations temporelles, apprécier les tendances à l’œuvre, appréhender les évolutions probables à court terme. De son côté, Bank Al-Maghrib utilise des outils d’analyse et de prévision dans l’exercice de ses missions. BAM a renforcé son dispositif de prévision en développant un modèle macroéconomique qui accorde une attention particulière au fonctionnement du système financier. La Banque centrale affine ses prévisions de court terme par une analyse des principaux indicateurs sectoriels. Elle recourt aux informations sur le secteur industriel, livrées par son enquête de conjoncture. Elle a aussi procédé au renforcement de son dispositif d’analyse de l’inflation par l’élaboration d’indicateurs propres. La production des statistiques monétaires lui permet de renforcer le cadre analytique de la transmission de la politique monétaire à l’ensemble de l’économie réelle. Le troisième grand producteur national de prévisions de croissance est le ministère des finances. De sa prévision dépend notamment le niveau attendu des recettes fiscales et donc le solde budgétaire. Le budget du gouvernement est souvent basé sur des prévisions supérieures à celles du consensus de la plupart des autres prévisionnistes. La nouvelle loi organique de finances insiste sur le respect du principe de sincérité des comptes publics et des hypothèses de prévision économique. Même si ce principe est appliqué, il n’en reste pas moins que les enjeux et controverses de la modélisation macro– économique, les apports et les limites des différentes méthodes de prévision, la pertinence des hypothèses retenues quant au comportement de certaines variables clés : année agricole, cours du pétrole et des matières premières, taux de change…, donneront toujours lieu à des différences dans les prévisions. Mais les organismes publics ne sont pas les seuls à s’intéresser à l’évolution de la conjoncture économique. Le FMI et la Banque Mondiale publient eux aussi des chiffres suivis de près par les acteurs économiques.
Au centre des prévisions, il y a des modèles qui relient des causes et des conséquences. Leur «nourriture» de base est la comptabilité nationale : cette série de chiffres, produite par le HCP, comprend le PIB, la consommation, l’investissement, les prix, le chômage… Les modèles utilisent des centaines de variables, et les chiffres qui leur sont associés. Ensuite, les modèles les combinent, en établissant des dizaines de relations de causalité entre elles. Par exemple, qu’est-ce qui influence le taux d’épargne ? Qu’est-ce qui fait varier le taux de chômage ? Pour établir ces relations, on fait appel à la fois à la théorie économique, puis à l’observation des situations réelles du passé. Les modèles sont réglés différemment. Cela relève à la fois des présupposés économiques ou de considérations techniques. Après avoir fait tourner le modèle, il faut analyser les écarts entre ce que livre le modèle et les dernières tendances constatées. A cette étape intervient une part de jugement, les experts s’autorisent à modifier la prévision à la marge du modèle. Des erreurs peuvent se produire : des choses que vous n’avez pas, ou mal, anticipées dans la politique économique; ensuite, un changement de politique; enfin, une erreur de raisonnement ou une mauvaise intuition.
Les prévisions économiques sont un exercice délicat qui a ses règles, ses hypothèses et ses méthodes. Dans cet exercice, le rôle que présente le monitoring de la conjoncture dans la prévision macroéconomique est fondamental. Les problèmes que pose la prévision stricto-sensu de la production agricole sont progressivement surmontés ; le développement du système agro-météorologique permet aujourd’hui une détection précoce des effets des aléas climatiques sur la production agricole. Mais des difficultés méthodologiques persistent pour la modélisation du lien entre le comportement des variables de la prévision agricole et l’évolution des autres variables explicatives de l’évolution de l’économie nationale.
