Idées
Les enjeux du Maroc en émergence
Pour pouvoir amorcer une dynamique de convergence future avec les pays riches, tout pays émergent ou en émergence doit s’inscrire dans un processus d’immersion gagnant dans la mondialisation par l’attraction des investissements et le développement des exportations
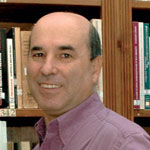
Comment caractériser aujourd’hui un pays émergent? Une réponse concise à cette question est difficile à formuler. Il suffirait de se référer aux listes de pays établies par les institutions internationales pour constater que le club de pays émergents ne cesse de s’étendre sans qu’il soit réellement possible de repérer des critères réellement communs. Au-delà des définitions parfois floues la question qui se pose est: l’émergence est-elle un processus qui ouvre la voie au développement ? La notion de «pays émergents» a été élaborée dans une optique «opérationnelle»: Faire le tri parmi les pays en développement entre les bons et les mauvais performeurs. Ce sont donc les indicateurs macroéconomiques de richesse et de performance à l’international, et non les indicateurs de développement humain, qui guident l’élaboration des listes. Pour pouvoir amorcer une dynamique de convergence future avec les pays riches, tout pays émergent ou en émergence doit s’inscrire dans un processus d’immersion gagnant dans la mondialisation par l’attraction des investissements et le développement des exportations.
A cette condition, doit être ajoutée celle de l’équité : la croissance doit être pro-pauvre. Le pays doit diversifier sans cesse sa structure de production, maintenir un cadre macroéconomique sain mesuré par le solde budgétaire et la balance commerciale. Un consensus semble désormais trouvé sur les facteurs les plus décisifs qui agissent sur l’évolution vers l’émergence. Ils s’inscrivent encore en pointillés dans les politiques publiques : l’accent doit être mis sur l’accumulation du capital physique en infrastructure de base, l’augmentation du capital humain reproductible via l’amélioration de la santé, de l’éducation et des conditions d’apprentissage et de l’emploi; la préservation du capital naturel et la disposition d’un capital social fait de relations sociales solidaires et de règles de droits sûrs et garantis. Le rôle de l’Etat reste essentiel dans la politique macroéconomique, la lutte contre l’exclusion et la gestion des biens publics. La qualité des institutions est un préalable à l’émergence : la croissance est corrélée avec les capacités des institutions à instaurer un Etat de droit, à protéger les droits de propriété, à réduire la corruption, à réglementer de manière transparente et efficace les marchés et à assurer la stabilité politique. La grande majorité des pays émergents tient régulièrement des élections nationales, régionales et locales, permettant à leurs citoyens de choisir leurs dirigeants politiques et de garantir la légitimité formelle des gouvernements. Mais l’élection ne fait pas la démocratie. Elle suppose davantage : une justice indépendante, une administration impartiale, une presse libre, la sécurité.
Les traits du modèle marocain révèlent un «paradoxe» : il est dans un processus de rattrapage mais la convergence est encore loin de se dessiner. Si la croissance et l’insertion dans la mondialisation constituent des aspects de sa dynamique, l’éventail des préoccupations sociales telles que la pauvreté, les droits du travail, l’environnement et les droits humains constitue des facteurs de retard du modèle. Le «modèle» marocain en émergence est différent aussi bien du modèle développementaliste des premières décennies de l’indépendance que de celui mis en avant par les Programmes d’ajustement structurels du «consensus de Washington». Certains des traits de sa configuration reposent sur la prééminence du rôle de l’Etat, sur la combinaison d’une nouvelle économie mixte, voire plurielle, sur une inscription dans la mondialisation allant de pair avec un volontarisme économique. Mais la configuration du «modèle» est insuffisamment institutionnalisée de sorte que les retours en arrière sont toujours du domaine du possible. La question du «modèle marocain émergent» soulève quelques enjeux. Un des enjeux de ce modèle provient de sa faible explicitation ; les pratiques sur le terrain institutionnel (Etat de droit, transparence, rendre compte..) sont souvent en retard sur le discours des acteurs politiques. Un deuxième enjeu lié étroitement au premier est celui de la démocratie. En effet, les divers acteurs collectifs doivent être de réelles parties prenantes dans la décision en favorisant des confrontations d’intérêts collectifs dans le cadre de la concertation à l’échelle nationale et des diverses instances intermédiaires. Si l’on veut que la configuration du modèle ne sombre pas dans une démocratie de complaisance, il faut prendre au sérieux la démocratie représentative et participative et investir lourdement dans les espaces de délibération (Parlement, conseils élus). Un troisième enjeu pour le «modèle» concerne sa capacité à faire en sorte que les exclus puissent faire valoir leur point de vue dans ce débat. On peut supposer que la dynamique d’une croissance ouverte et inclusive offre une porte d’entrée pour l’intégration sociale des groupes d’exclus. Si ce défi est relevé, il en résultera un enrichissement collectif qui dépasse les stratégies de croissance à tout-va. Il est donc évident que le modèle devra répondre à des attentes, refléter les valeurs et les préoccupations des citoyens. Le modèle devra aller plus loin que la simple mobilisation du potentiel économique du pays. Il devrait mieux cerner les relations entre les acteurs économiques et sociaux et se donner des institutions qui reflètent les attentes de la population.

