Idées
L’Empire du milieu à l’heure des choix
La crise financière chinoise fait trembler non seulement les bourses mondiales mais aussi les pays occidentaux et les partenaires de l’Empire du milieu.
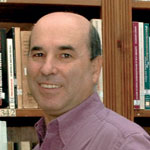
La difficulté de la Banque centrale chinoise à gérer le ralentissement de la demande de crédit sans provoquer un crédit crunch majeur fait craindre une éventuelle crise financière «à la subprime». Une panique pourrait déclencher des effets de contagion, les marchés financiers sont par nature volatils et moutonniers. Puis l’importance de la Chine sur l’échiquier économique mondial n’est plus à démontrer : deuxième puissance, premier exportateur, elle compte pour plus de 35% de l’ensemble de la croissance économique mondiale depuis 2008. Elle gère un matelas colossal de devises ; les placements financiers de ses fonds d’investissement sont plus redoutables que ses investissements directs à l’étranger. Autant dire qu’un fort et durable ralentissement de la Chine affecterait sérieusement l’économie mondiale. Son effet à court terme serait négatif pour les grands équilibres commerciaux de la planète. Les exportateurs chinois vont chercher à exporter à tout prix pour maintenir leur niveau de production. A l’inverse, la Chine va réduire fortement ses importations d’équipements et de matières premières puisque la demande interne diminue. Les pays développés ne seront pas les premiers touchés. Les pays les plus concernés sont d’abord les pays d’Asie qui sont dans une relation de «circuit intégré» avec la Chine, puis les pays émergents comme le Brésil ou l’Inde. Le deuxième effet concerne les marchés financiers : la pression à la baisse du yuan va engendrer le risque d’une guerre des monnaies ; les profits des grandes sociétés occidentales seront fortement affectés par le ralentissement chinois, ce qui ne manquera pas de se répercuter sur les bourses et par ricochet sur l’économie réelle. Tout dépendra comment la Chine va gérer sa sortie de crise. Le monde occidental est suspendu à ses décisions de court terme pour juguler la turbulence financière, il est surtout inquiet sur la capacité de la Chine à négocier un tournant dans son modèle de développement.
La croissance spectaculaire de la Chine au cours des dernières décennies a suscité dans les pays développés plus de crainte que d’admiration. La Chine devenait progressivement une grande puissance, ayant vocation à asseoir son leadership, non seulement au niveau régional mais également au niveau global, notamment en se faisant le porte-parole des pays émergents. Au cours des années 2000, la Chine a enregistré des taux de croissance souvent supérieurs à 10%. Avec la crise économique et financière mondiale les volumes de ses exportations vers les marchés occidentaux ont fortement diminué et le taux de croissance a ralenti (autour de 7%). Pékin, pour retrouver un rythme de croissance plus élevé, a mis en œuvre un plan de relance colossale de 575 milliards de dollars. Si cette politique d’offre a permis de garantir un certain niveau de croissance, la demande intérieure n’a pas suivi. Dans le sillage de ce plan de relance, l’offre de prêts émanant des banques locales s’est fortement accrue.
Le resserrement de la politique monétaire, à partir de 2010, a dans un premier temps ralenti la progression des crédits bancaires. Mais les banques ont transféré certaines créances hors de leurs bilans et proposé des produits de financement alternatifs (shadow banking) en contournant les nouvelles règles de la politique monétaire. Ainsi, une part croissante des financements de l’économie a été distribuée via ce processus. Dans ces conditions, le risque de crédit a augmenté fortement. La Chine doit également faire face à un fort accroissement de son endettement. Il serait aujourd’hui proche de 250% du PIB. L’excès de dette implique une montée des risques de crédit et de bulles sur les marchés immobiliers et/ou boursiers suite au ralentissement de l’activité.
Une réforme de l’économie chinoise et une réorientation de son modèle de croissance sont inévitables. C’est à cette condition que l’Empire du milieu parviendra à conserver une croissance dynamique. Depuis trente ans, la Chine a adopté un modèle de croissance qui a permis au pays de sortir du sous-développement pour devenir aujourd’hui la deuxième économie mondiale. Ce modèle, dont le moteur principal est constitué par les exportations, a engendré, depuis plusieurs années, des tendances qui pouvaient le conduire dans l’impasse : dégradation des termes de l’échange, faiblesse de la consommation privée, dégâts environnementaux considérables, etc. L’enjeu des années à venir est de transformer une société industrielle et agricole en une société de consommation et de services. Il implique des réformes structurelles de grande ampleur dans le secteur public, la finance, le droit de propriété, le modèle social, le développement urbain, etc.
La nécessité d’engager les réformes qui permettront l’avènement d’un nouveau modèle de croissance et rendront possible la modernisation de l’économie et de la société est une évidence pour les instances dirigeantes. Mais la question qui hante le Parti communiste chinois est de trouver les moyens d’assurer cette transition socio-économique sans que celle-ci ne s’accompagne d’une transition politique. Une vraie quadrature de cercle.
En Chine, le développement d’une économie de marché dominée par une forme de capitalisme bureaucratique (crony capitalism) a permis à bon nombre de hauts dirigeants de s’enrichir dans un climat marqué par la corruption et les privilèges. Dans le même temps, les inégalités ne cessent de s’aggraver, suscitant la colère d’une société chinoise qui a beaucoup changé et qui est de plus en plus consciente de ses droits. Réformer ou mourir ? Le dilemme auquel sont confrontés les dirigeants chinois a été bien résumé par l’historien de la Chine moderne Zhang Ming : ils ont le choix entre attendre la mort ou chercher la mort.

