Culture
Le livre du rire et de l’inoubliable
En 1975, l’écrivain français Romain Gary se dissimule derrière le pseudonyme à‰mile Ajar pour écrire «La vie devant soi», un roman extraordinaire, qui nous fait rire aux larmes face à d’indicibles chagrins.
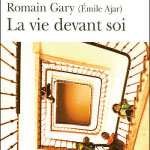
Au début, Momo ne sait pas qu’il n’a pas de mère. «Je ne savais même pas qu’il en fallait une», marmonne l’enfant, ennuyé. Car Momo a Madame Rosa, la grosse et moche et vieille Madame Rosa, son pilier de graisse et de rides à lui, son mur des lamentations, surtout après avoir gravi, en soufflant, six étages d’escaliers. «Je mettais la main sur sa poitrine et je sentais son coeur, malgré tous les kilos qui nous séparaient», se souvient le gosse, ému. Madame Rosa, c’est le dernier rempart de Momo contre l’Assistance publique, contre la rue, son refuge mais aussi celui de Banania et de Moïse, de tous ces «mômes qui n’avaient pas pu se faire avorter à temps et qui n’étaient pas nécessaires», résume-t-il, lucide à tout juste dix ans.
Vu comme ça, le roman est une source inépuisable de chagrin. Et puis quels personnages! Si peu «glamour», si peu présentables. Une vieille juive obèse hantée par les camps, qui tient une crèche clandestine pour enfants de femmes «qui se défendent» à Pigalle, pour enfants de prostituées, si vous préférez. Une ribambelle de petits Arabes, de petits Africains, de petits Juifs, aux mères si ingrates, si indignes qu’elles en oublient même de payer. Il y a aussi les maquereaux de ces dames, Momo les appelle des «proxynètes», comme ce Monsieur N’da Amédée qui vient souvent se faire rédiger des lettres par Madame Rosa, car il ne sait pas écrire, mais personne ne doit le savoir. «Quand il parlait, Monsieur N’Da Amédée faisait des gestes et s’émouvait et finissait même par se fâcher sérieusement et par se mettre en colère, pas du tout parce qu’il était furieux mais parce qu’il voulait dire à ses parents beaucoup plus de choses qu’il ne pouvait s’offrir avec ses moyens de bas étage. Ça commençait toujours par cher et vénéré père et puis il se foutait en rogne car il était plein de choses merveilleuses qui n’avaient pas d’expression et qui restaient dans son cœur». Pas un personnage pour rattraper l’autre, vous dis-je.
Ode à la vieillesse
Mais attendez que je vous révèle comment l’écrivain a réussi à faire de ce contexte effroyable une marrade totale: d’abord par le langage que déploie Romain Gary, une fabuleuse prouesse stylistique. Momo, le narrateur, a entre neuf et quatorze ans et doit donc parler comme les enfants de son âge, capturer des mots, des expressions d’adultes, les tordre, les malaxer, les recracher à sa manière. Cela donne des phrases d’une naïveté irrésistible, des maladresses sublimes, qui expriment souvent mieux la réalité que les maximes les plus savantes, les plus tarabiscotées. Voyez, par exemple, comment il décrit la décrépitude de sa vieille mère par défaut : «Malheureusement, Madame Rosa subissait des modifications, à cause des lois de la nature qui s’attaquaient à elle de tous les côtés, les jambes, les yeux, les organes connus tels que le cœur, le foie, les artères et tout ce qu’on peut trouver chez des personnes très usagées». Plus loin : «La seule chose qu’elle ne voulait pour rien au monde, c’était le cancer, et là elle avait de la veine vu que c’était la seule chose qu’elle n’avait pas». Monsieur Hamil, l’autre pilier de Momo, un sage vieillard qui sombre, peu à peu, dans la démence, a droit, lui aussi, à des descriptions magnifiques de candeur et d’intelligence : «Je voyais qu’il faisait un gros effort pour se rappeler, mais tous ses jours étaient exactement pareils depuis qu’il ne passait plus sa vie à vendre des tapis du matin au soir, alors ça faisait du blanc sur blanc dans sa tête». Le même Monsieur Hamil, au faîte de sa lucidité, disait à Momo que «le temps vient lentement du désert avec ses caravanes de chameaux et qu’il n’était pas pressé car il transportait l’éternité».
Romain Gary sait que la vieillesse déclinante n’intéresse que très médiocrement, n’intéresse même, peut-être, que ses protagonistes agonisants. Alors il la raconte du point de vue magique, émouvant du gosse de dix ans, un point de vue qui nous fait, sur le coup, sourire, rire aux éclats puis, réflexion faite, qui nous prend aux tripes, nous marque durablement. Un livre «de toute beauté», «croyez-en ma vieille expérience».

