Idées
L’ALECA, son impact, ses enjeux…
Il est fondamental pour le Maroc de réaliser des études d’impacts similaires et pertinentes, en amont comme en aval des négociations, pour mieux définir sa vision, ses centres d’intérêts, ses priorités et améliorer son propre regard sur l’évaluation des impacts économiques, environnementaux et sociaux des accords d’une si grande importance pour son avenir.
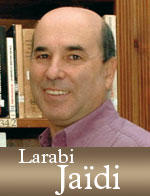
Le troisième round de négociations autour de l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) entre l’Union européenne et le Maroc est lancé. Ces négociations portent sur les apports de cet accord dont le but est de faciliter l’intégration approfondie de l’économie marocaine dans le marché intérieur de l’UE. Elles couvrent tous les aspects présentant un intérêt commun pour les deux parties, y compris les obstacles tarifaires et non tarifaires, les services, l’investissement, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence et les marchés publics. Elles englobent toutes les dimensions de la coopération politique et des volets sectoriels. Le résultat des impacts positifs et négatifs générés au niveau de toutes ces dimensions détermine le niveau de bien-être et de durabilité du mode de développement induit par l’approfondissement de la zone de libre-échange.
Selon les résultats de cette étude d’impact, un accord approfondi de libre-échange entre l’Union et le Maroc se traduirait par une augmentation de la prospérité des deux partenaires. Le Maroc devrait bénéficier à terme d’une augmentation de plus de 1,3 milliard d’euros en revenu national, d’une hausse des exportations de 15,3% plus élevée que celle des importations de 8,4%. L’analyse d’impact a fait également la lumière sur les principaux obstacles au développement des échanges entre les deux partenaires : les barrières non tarifaires, la divergence des réglementations sectorielles, l’absence de transparence des marchés publics et les problèmes liés aux droits de propriété industrielle (DPI). L’analyse quantitative sur les effets sociaux de l’ALECA n’a pu être menée à cause de l’indisponibilité d’une base de données récente et complète sur les ménages. Les effets attendus sur la pauvreté et le bien-être ont été évalués de façon qualitative. Les salaires réels des travailleurs devraient augmenter à long terme. La Commission prévoit une augmentation globale de l’emploi même si des pertes limitées sont prévisibles dans certains secteurs. L’analyse d’impact comporte un volet sur les répercussions environnementales de l’accord de libre-échange, et se penche plus sur trois effets possibles de l’ouverture des marchés sur l’environnement : les «effets d’échelle» (augmentation de l’activité économique), les «effets de composition» (modifications des modèles de production et de consommation) et les «effets techniques» (amélioration de la maîtrise des émissions). Selon la commission, les incidences négatives sur les déchets, la biodiversité et les ressources naturelles sont atténuées dans une certaine mesure par l’augmentation des échanges de produits et services respectueux de l’environnement. En ce qui concerne la situation des droits de l’homme, l’effet de l’accord serait positif et indirect, par des avancées des droits économiques et sociaux plutôt que par l’évolution des droits culturels civils ou politiques.
Dans son ensemble, l’analyse d’impact comporte une évaluation s’appuyant sur une grande quantité de données, tant quantitatives que qualitatives, et utilise un modèle informatisé d’équilibre général. Cependant, le recours à ce modèle informatisé d’équilibre général est critiquable en raison des réserves que l’on peut émettre quant à l’obtention de résultats fiables et réalistes, compte tenu notamment de l’indisponibilité ou de la non-fiabilité de certaines données. La grande complexité des questions étudiées oblige à formuler des hypothèses de travail discutables sur le plan méthodologique. De plus, les données disponibles sont parfois très lacunaires : il manque en particulier des statistiques désagrégées sur l’impact de flux commerciaux bilatéraux spécifiques sur les secteurs qui ont une relevance en matière d’environnement, de droits de l’homme ou de la situation des hommes et des femmes. Par ailleurs, en raison de ces problématiques, l’étude d’impact en termes de développement durable réalisée pour le compte de l’UE ne permet pas, malgré la masse de travail consentie, de répondre de manière concluante à ces questions, que ce soit de façon prospective ou rétrospective. Les nombreuses limites de la modélisation économique ont conduit les experts à utiliser des techniques de recherche qualitative basées sur les entretiens avec les parties prenantes et l’utilisation de sources secondaires d’information pour évaluer les conséquences en termes de développement durable. Une place importante a été réservée aux consultations avec les parties prenantes mais globalement l’étude, bien qu’utile, souffre de nombreuses limites.
La méthodologie pâtit des lacunes et insuffisances du modèle d’équilibre général calculable ; une trop forte importance est donnée à la dimension économique ; les mesures d’atténuation des effets d’impact négatifs ne sont pas suffisamment explorées ; les défis liés à la consultation des parties prenantes sont encore nombreux : dialogue insuffisamment structuré, manque de suivi et de soutien au renforcement des capacités de la société civile. On note aussi l’absence de cadre unifié pour organiser cette combinaison entre les approches quantitatives et qualitatives -ceci compromet la qualité et la cohérence des analyses conduites. La structure même du référentiel n’est pas accompagnée d’indicateurs d’engagement et de résultats. Enfin, il est fondamental pour le Maroc de réaliser des études d’impacts similaires et pertinentes, en amont comme en aval des négociations, pour mieux définir sa vision, ses centres d’intérêts, ses priorités et améliorer son propre regard sur l’évaluation des impacts économiques, environnementaux et sociaux des accords d’une si grande importance pour son avenir.

