Idées
Projet Renault-Tanger : fébrilité et frilosité à la française
A entendre les commentaires des politiques de tous bords provenant de l’Hexagone concernant l’implantation d’une usine Renault à Tanger, on demeure pantois ! Il n’y a pas eu de fermeture d’unité industrielle consécutivement à ce projet et la France est gagnante sur le plan commercial grà¢ce à une demande supplémentaire en biens et services. Alors de quoi parle-t-on ?
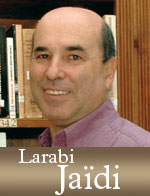
Les commentaires n’ont pas manqué : «Insupportable, scandaleux, erreur stratégique, dumping social, détournement de l’argent du contribuable, stratégie suicidaire pour la France….». A les entendre, on se demande quel est ce cataclysme qui a fait trembler la puissance de la France. On demeure pantois quand on relève que ces réactions viennent de ténors de la classe politique française à l’adresse du projet Tanger Renault. Une levée de boucliers à droite comme à gauche, des souverainistes aux internationalistes en passant par les gaullistes. Tous accusent la firme au losange de trahison, de désertion, de comportement amoral. Mais qu’est-ce qui a conduit ces leaders, ces faiseurs d’opinion à perdre la raison ? Une poussée de fébrilité dans une campagne électorale hyper chahutée par un discours nationaliste des temps anciens ? Peut-on accepter que pour un braconnage de voix on sacrifie les valeurs de solidarité, d’ouverture, de dialogue que l’on considère fondatrices de l’identité française ? Une frilosité face à la perte de compétitivité de quelques pans de l’industrie nationale ? Peut-on admettre que la reconquête de la capacité industrielle française se fera par un repli sur soi, une attitude défensive en totale rupture avec l’évolution des stratégies des firmes ?
Aucun pays ne fabrique l’intégralité d’une voiture à l’intérieur de ses propres frontières
Alors comme le suggérait un commentateur plus serein, faisons appel à notre cerveau gauche, centre de l’analyse et du raisonnement pour analyser les termes de cette équation. Le cerveau droit, siège des émotions, ne provoquera que pleurs ou lamentations. Une lecture sereine de la logique de ce projet fera la démonstration de l’absurdité de positions motivées par des calculs de conjoncture. Car, c’est depuis des années que l’industrie automobile mondiale, y compris française, est entrée dans une phase de profondes mutations qui ont provoqué l’éclatement de nombre de schémas classiques. Le véhicule automobile ou même un modèle d’une marque ne peut plus être construit dans son intégralité dans un seul pays. Les procédures classiques d’exportation ont reculé au profit de mécanismes complexes de délocalisation de la production ; les règles habituelles de concurrence ont dû faire place à l’explosion des procédures de coopération ; les pays du Sud jusqu’alors marginalisés ont vu leur rôle s’accroître. Les constructeurs se sont engagés dans une vaste réorganisation des procédures d’approvisionnement ; le développement et la fabrication des produits tendent à s’effectuer en commun (Renault-Nissan en est l’exemple) et les constructeurs coopèrent avec des équipementiers dont ils stimulent la localisation.
La filière de l’industrie automobile est l’une des plus éclatées et des plus internationalisées. Renault en est aussi un prototype. Dans la composition d’une voiture, quelle qu’en soit la marque, interviennent des dizaines de pièces venant de fabricants localisés dans différentes contrées du monde. Aucun pays ne fabrique l’intégralité d’une voiture à l’intérieur de ses propres frontières. Ainsi veut la mondialisation. Désormais, la nationalité d’une firme est elle-même objet de questionnement. C’est plus la marque, la référence à une qualité, à une histoire qui donne désormais une identité nationale à un produit. La division du travail au sein de cette industrie se redéploie sous de nouvelles modalités : la recherche technologique, le know-how, le brevet et la marque sont toujours le monopole de grands constructeurs ; le reste, la fabrication du moteur et des autres composants se répartit sur toutes les sphères du globe. Des coopérations et des partenariats dans la recherche et la fabrication de pièces nobles se nouent entre concurrents.
Dans une filière automobile interviennent trois grands segments : les constructeurs, les équipementiers de différents rangs et les assembleurs. Les relations entre ces trois intervenants est en constante évolution. Fini le temps où le constructeur imposait ses conditions, ses normes, ses choix aux autres. Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants se modifient. Les sous-traitants peuvent imposer leurs conditions aux constructeurs. Le choix de localisation territoriale d’un constructeur n’est déterminé qu’en fonction de ses préférences.
La localisation de Renault à Tanger est le résultat d’une négociation où le Maroc n’était pas une simple partie prenante passive. Il a fait valoir ses atouts et sa force d’attractivité : l’offre d’une plateforme foncière aménagée aux standards internationaux ; un partenariat financier avec la CDG pour couvrir le retrait de Nissan ; un accompagnement des banques marocaines ; des infrastructures logistiques dans un site en plein développement ; des incitations fiscales ; la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et formée pour les besoins du projet ; des réformes de la législation qui participent à la maîtrise des coûts et des délais de livraison. En clair : le Projet Renault Maroc est un partenariat. Véhiculer l’idée que la localisation du projet est la résultante d’un seul facteur : la compétitivité-coût de la main-d’œuvre marocaine est une méprise qui alimente une fausse polémique. D’autant plus que le coût de la main-d’œuvre annoncé est loin de correspondre à la charge salariale moyenne réelle dans une industrie où l’encadrement intermédiaire et les hautes qualifications sont importants. Alors, de grâce, ne parlons pas de dumping social.
Le projet Renault Tanger ne résulte pas de la fermeture d’une usine
Par ailleurs, le projet-Renault Tanger est source de demande en biens et services adressée à l’économie française. Dans la balance des échanges, la France n’est pas perdante. D’autant plus que le projet ne résulte pas de la fermeture d’une usine ou d’une délocalisation. C’est une création nouvelle, pour la fabrication de modèles au coût de production peu compétitifs en France, venue en apport à la saturation des capacités d’un site situé en Roumanie. La firme dispose encore d’une vingtaine de sites de production en France et d’un nombre équivalent dans différents pays du globe : Turquie, Roumanie, Espagne, Corée du sud, Argentine, Slovénie, Russie, Colombie… Alors quel est le sens de pointer du doigt un projet qui se situe dans la droite ligne d’une stratégie internationale de la firme ?
Un flash-back renseignera mieux sur la futilité de ces gesticulations. Il y a une vingtaine d’années, la fermeture du site de Renault Boulogne Billancourt avait fait couler beaucoup d’encre sur les pertes d’emplois, le drame des familles privées de travail ou redéployées vers d’autres sites. Cette opération de démantèlement de l’usine n’a pas empêché le site de se revitaliser en redéfinissant son profil et sa fonctionnalité, ni Renault de gagner en puissance dans la compétition mondiale. Il y a vingt ans aussi, la France, bousculée dans l’arène de la compétitivité mondiale, avait adopté un programme intitulé Made in France, calqué sur l’approche Made in América lancée avec succès par les Etats-Unis quelques années auparavant en vue de reconquérir des positions dans des secteurs technologiques (électronique, informatique) laminés par la montée du Japon. Le programme français, fondé sur un diagnostic pertinent de la perte de compétitivité de l’industrie française, a ciblé diverses actions de revitalisation industrielle dans les domaines de la recherche/développement, de l’appui aux entreprises, de l’aménagement des territoires.
Les pays les plus performants sont ceux qui anticipent le mouvement d’internationalisation en se positionnant dans les pays de proximité
Mais les facteurs de compétitivité se modifiant dans le temps, l’effet de ce programme fut de courte durée. La leçon à retenir, pour la France d’hier comme pour le Maroc d’aujourd’hui, il n’y a point d’avantage compétitif naturel, absolu ou durable, il n’y a que des avantages construits et perpétuellement redéfinis en fonction de l’évolution des conditions de la concurrence mondiale.
La position de la classe politique française sur Tanger-Renault est encore moins compréhensible si nous l’approchons par référence aux stratégies poursuivies par les pays européens ou asiatiques pour redéfinir les termes de la compétitivité de leur industrie automobile. Justement, les pays les plus performants dans le monde sont ceux qui anticipent le mouvement d’internationalisation en se positionnant dans les pays de proximité, par des opérations d’implantation qui participent à la construction d’une cohérence productive régionale fondée sur la mobilisation des atouts distinctifs des pays de la région. Regardez comment les firmes japonaises ont fait de l’Asie du sud un espace d’influence qui sécurise sur une longue durée les marchés et le potentiel de croissance des entreprises nippones. Regardez comment l’Allemagne, dont la France officielle salue la rigueur et la performance économiques, a conquis une présence productive dans l’aire germanique et dans les pays de l’ex-zone soviétique et en a fait une force de frappe industrielle. De manière générale, dans ce processus de redéploiement productif de l’automobile ou d’autres industries, l’autonomie passe par la maîtrise de technologies de très haut niveau ; à l’intérieur de ces technologies nodales il existe un niveau fondamental : la capacité de conception. Et l’autonomie ne signifie pas l’absence de dépendance, bien au contraire ; le problème est celui de la gestion coopérative de l’interdépendance dans le sens de l’autonomie.
Aujourd’hui, la conquête des marchés de proximité par les simples courants commerciaux est révolue. Il en est de même de la simple création d’ateliers d’assemblage ou de conditionnement. Désormais, une filière industrielle ne garantit la pérennité de sa compétitivité qu’en étalant sa chaîne de valeurs dans différents territoires. L’avantage compétitif est remodelé par la logique de comportement des firmes, il se construit par la coopération inter-nations et intra-firmes. Alors continuer à raisonner à l’échelle de l’Hexagone et ne voir dans les pays proches qu’un marché pour placer des TGV, des Airbus et des Rafales ou prendre des positions dans la gestion déléguée des services publics est une courte vue. On ne peut appeler à libérer les barrières douanières, louer les vertus du modèle libre-échangiste et vouloir contrôler les flux de main-d’œuvre et de capitaux. Les libertés économiques comme les libertés individuelles sont indivisibles. C’est une déclaration universelle de Paris qui nous l’a appris.

