Affaires
Amo : gare à la dérive ! Le patron de l’Anam tire la sonnette d’alarme
Tarifs, ordonnances, radios et biologie, pour Chakib Tazi, il est urgent de maîtriser les dépenses de l’assurance maladie qui sont anormalement élevées.
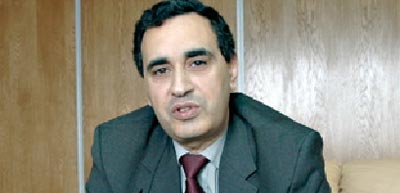
Bataille feutrée entre assureurs privés et CNSS autour du basculement de 400 000 salariés vers le système de base de l’Assurance maladie obligatoire (Amo), conflit ouvert entre cette même CNSS et la CNOPS, gestionnaires du système avec les médecins du privé à propos des tarifs pratiqués par ces derniers, on a rarement vu l’Agence nationale de l’assurance maladie (Anam), régulateur, prendre position. Certains expliquent cette retenue par le devoir de réserve qu’elle doit s’imposer en tant que régulateur.
Pourtant depuis qu’elle est installée et avec du recul, l’Anam a eu le temps de développer un diagnostic assez limpide de la situation. Le diagnostic n’est pas compilé ni formalisé mais quand on interroge l’agence sur les différents volets qui font l’objet aujourd’hui de polémique un même constat revient en force : lutter contre les gaspillages, non justifiés par les impératifs de santé des malades, pour maîtriser les dépenses.
Médecins : des tarifs de chirurgie aussi élevés qu’en France !
Premier volet, celui des tarifs des médecins. A ce niveau, l’analyse développée par l’agence est que les tarifs appliqués aujourd’hui par les médecins sont en inadéquation avec le pouvoir d’achat. L’analyse basée sur des comparatifs avec d’autres pays aboutit inéluctablement au fait que certains tarifs au Maroc sont paradoxalement plus élevés en termes de pouvoirs d’achat que ceux pratiqués dans des pays plus riches. Exemple de la chirurgie où l’unité de base servant au calcul de l’acte est le K. En France, le K est valorisé entre 1,92 et 2,08 euros, soit en moyenne 22 DH alors qu’au Maroc il est de 22,50 DH. Cela se passe de tout commentaire. Autre exemple, celui des analyses de biologie médicale. Là aussi un benchmark réalisé récemment par l’agence a démontré que les Marocains paient la biologie plus chère que les Français ou encore les Belges.
«C’est là une situation que nous héritons et qui s’impose à nous et il faut la gérer pour construire quelque chose de plus pérenne», explique le DG de l’agence, Chakib Tazi. Pour ce dernier, le niveau élevé des tarifs de certaines prestations n’est pas uniquement le fait de ces derniers mais résulte aussi de la rareté de l’offre de soins au Maroc. Car, malgré l’avancée réalisée ces dernières années, le Maroc reste encore en manque de médecins et de personnel paramédical. Au Maroc, on compte aujourd’hui un médecin pour 1 600 habitants alors que la norme de l’OMS est d’un médecin pour 500 habitants. Idem pour le personnel paramédical (infirmiers et autres) qui doit être à une moyenne de 4 personnes par médecin tandis qu’au Maroc on en est à 1,25 seulement. Et c’est cette rareté conjuguée à une mauvaise répartition géographique qui fait que les tarifs soient chers. En somme, la théorie économique de Ricardo selon laquelle la rareté fait la valeur. Toutefois il faut mettre à la charge de cette situation un accès limité aux soins qui implique un enchérissement de certains actes. L’AMO a pour vocation d’élargir cette couverture moyennant une revue des tarifs à la baisse pour certaines prestations, sans exclure la revalorisation des actes sous-tarifés.
Mais pour la direction de l’Anam, au-delà de la question des tarifs, le vrai débat à instaurer avec les médecins se situe au niveau de la qualité et de la pertinence de leurs prestations.
Trop de médicaments prescrits et des analyses et radios parfois inutiles
Or là réside l’une des grandes difficultés auxquelles est confrontée l’agence : comment mesurer et évaluer la pertinence de la prestation d’un médecin ? Comment faire en sorte que les médecins prescrivent ce qu’il faut pour soigner le malade tout en prenant en compte la contrainte de l’équilibre du régime de l’assurance maladie ? La problématique n’est pas propre au Maroc. Bien des pays avant nous ont été confrontés au problème et la réponse a été trouvée depuis longtemps : elle s’appelle les protocoles thérapeutiques. Il s’agit, comme leur nom l’indique, de protocoles dûment validés par des comités scientifiques, dont font partie les médecins eux-mêmes, et qui définissent avec précision la procédure à suivre en fonction du cas du patient. Ils déterminent notamment, et c’est le plus important, la nature des examens (analyses, radiologies…) que le médecin doit demander ainsi que les médicaments à prescrire. De tels protocoles, explique-t-on auprès de l’Anam, ont pour objectif d’harmoniser les pratiques médicales et surtout de maîtriser les dépenses. En effet, pour un diagnostic, par exemple, que peut révéler une simple radiologie que beaucoup de médecins passent directement à des catégories plus élaborées et plus chères comme l’IRM. Pour l’agence c’est là où commence le gaspillage. Idem pour les médicaments qui représentent 50% de la dépense de la couverture maladie. Le constat de l’Anam à ce sujet est très clair : les médecins marocains prescrivent trop de médicaments par rapport aux standards internationaux. Pour s’en convaincre il faut savoir, par exemple, que dans les pays nordiques 72% des consultations médicales ne donnent pas lieu à des ordonnances ni à des prescriptions de médicaments. A cela s’ajoute le fait que les médicaments prescrits sont souvent chers parce que généralement des princeps.
L’agence travaille depuis 2007 à l’élaboration de protocoles thérapeutiques. Actuellement, trois protocoles concernant l’hypertension artérielle et la néphrologie sont sur le point d’être validés puis mis en application par le ministère de la santé. Deux autres, relatifs au diabète et à la maladie de Crohn affectant l’appareil digestif, vont être incessamment soumis à la validation du ministère tandis que 15 autres sont toujours en cours d’élaboration. Les protocoles thérapeutiques ainsi adoptés n’auront pas force de loi mais de recommandations. Cela dit, à terme, il n’est pas impossible que le non-respect répétitif d’un médecin de ces protocoles puisse l’exposer à des sanctions.
50% des dépenses de santé vont aux médicaments alors qu’ailleurs elles ne dépassent pas 20%
La question des prescriptions débouche in fine sur le deuxième volet chaud du dossier : le médicament. L’enjeu est de taille, aujourd’hui, 50% des dépenses de la CNOPS et de la CNSS vont dans le médicament au moment où en France, par exemple, cette part est de 18% et de 8 à 10% seulement dans les pays nordiques.
Si la rationalisation en amont, par le biais des prescriptions des médecins peut aider, à l’Anam on reste convaincu qu’une grande partie de la solution réside dans l’encouragement du médicament générique. Et pour cela, un passage obligé : le pharmacien. Ce dernier, grâce au droit de substitution, doit jouer un rôle majeur et c’est pour cette raison que les textes instaurant ce droit verront le jour incessamment. Evidemment, pour encourager le pharmacien à utiliser ce droit de remplacer un princeps par un générique, ce dernier doit être attrayant en termes de gains. Or, explique le patron de l’Anam, «avec le système actuel des marges, le pharmacien n’a aucun intérêt à vendre un générique puisque sa marge sera moins importante». Ce qui explique d’ailleurs l’autre mesure majeure que le ministère s’apprête à prendre en donnant des marges égales pour le générique et son princeps, et en instaurant le droit de substitution par les pharmaciens.
Il restera alors à convaincre les médecins qui sont nombreux à dire que le générique n’est pas aussi efficace que le princeps et demandent par conséquent des garanties, communément appelées la bioéquivalence attestant de l’efficacité du médicament. Du côté de l’Anam, il est expliqué que l’industrie pharmaceutique marocaine est aujourd’hui dûment reconnue comme étant aux standards les plus élevés aussi bien par les Européens que par les pays d’Amérique du Nord.
Mais si les problèmes des tarifs, du générique, entre autres, relèvent de l’immédiat, pour le directeur de l’Anam, l’autre réflexion sérieuse qu’il faut impérativement mener dès aujourd’hui concerne le long terme. «La réussite de l’Amo, précise M. Tazi, passe par un changement profond des mentalités, un changement sociétal. Nous pouvons maîtriser nos dépenses médicales en agissant en amont sur notre mode de vie, nos habitudes alimentaires, notre hygiène de vie». Et enfin, prévient-il, «l’Amo ne sera jamais réellement pérennisée si l’on oublie sa philosophie fondatrice qui est la solidarité». Une réflexion qui renvoie à un autre débat tout aussi houleux que les précédents et qui n’est toujours pas tranché, à savoir le basculement vers l’Amo des entreprises du secteur privé aujourd’hui couvertes par les compagnies privées (voir encadré).

