Idées
La défense commerciale, une complexe nécessité
Chronique de Larbi JAIDI
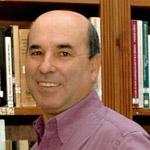
Le commerce extérieur est un sujet de la plus haute importance : il a des conséquences dans tous les domaines, et suscite des inquiétudes considérables. Le Maroc, comme la plupart des économies importatrices, souhaite appliquer un système d’instruments de défense commerciale pour défendre les producteurs nationaux contre le commerce déloyal. Le texte de loi qui sera mis en examen invite à mener une réflexion publique sur la façon dont le Maroc peut en tirer le meilleur parti au regard des réalités nouvelles de l’économie mondialisée. Au cours des dix dernières années, la structure de l’économie du monde et du Maroc a connu d’importants changements. Ces changements, induits par la libéralisation des échanges, remettent en question les conceptions protectionnistes habituelles. Mais ils appellent une nouvelle forme de régulation qui protégerait un pays qui s’ouvre à l’échange international contre les multiples formes de concurrence déloyale.
Les instruments de défense commerciale sont au nombre de trois : l’instrument antidumping, l’instrument antisubvention et les mesures de sauvegarde. Ils trouvent leur base dans les accords de l’OMC. On parle de commerce déloyal dans les deux premières situations. On évoque le dumping lorsqu’il s’agit d’une discrimination de prix entre deux pays. Par exemple, un producteur chinois vend ses micro-puces sur le marché chinois à un prix plus élevé qu’à l’importation dans un pays tiers. Quant à la subvention, elle incite à l’exportation en donnant un avantage aux exportateurs. Cela est interdit par l’OMC : les exportations incitées seraient en concurrence avec une industrie locale. L’OMC considère également qu’il y a subvention quand l’Etat n’empoche pas des revenus auxquels il a droit : il peut donc y avoir subvention même quand il n’y a pas transfert d’argent. Généralement, on utilise la plupart du temps l’instrument antidumping, parfois l’instrument antisubvention et très rarement les mesures de sauvegarde. Les instruments se concentrent sur les prix, mais aussi à la qualité de certains produits finis afin de les comparer. Cependant, l’accord de l’OMC ne permet pas encore de prendre en compte des critères environnementaux ou sociaux. Il n’existe pas, dans le cadre de l’OMC, de règles de protection sociale contre la non-application des règles minimales du travail ou de mesures contre les exportateurs qui opèrent dans des pays qui n’ont pas signé le protocole de Kyoto.
Quelle est la force de ces règles par rapport à la volonté démocratique et politique d’un pays ? Un État représente les citoyens ; s’il choisit de subventionner une entreprise, c’est un choix démocratique, or il est incompatible avec l’OMC. Vous allez me dire quelle est la force juridique des règles de l’OMC ? Les Instruments de défense commerciale conçus et mis en oeuvre en conformité avec les règles de l’OMC se caractérisent par leur utilisation modérée pour pallier l’absence de règles internationales de la concurrence et d’outils multilatéraux permettant de lutter efficacement contre les pratiques commerciales déloyales. Leur spécificité repose sur le fait qu’en dissuadant le recours à des méthodes non-concurrentielles, ils contribuent à promouvoir la libéralisation des échanges dans le respect des règles internationales.
Un texte de loi est donc d’une grande utilité pour éviter que la libéralisation ne soit assimilée à une ouverture sauvage et pernicieuse. Mais le texte de loi ne peut être un facteur de dissuasion que si son mode d’application est précis et maîtrisé. Les pouvoirs publics, en l’occurrence la Direction du commerce extérieur chargée de son suivi, ne peuvent agir que sur la base d’une plainte soumise par une activité : l’initiative revient donc aux professionnels. La plainte doit être représentative, ce qui pose des problèmes. Certaines activités sont bien organisées, elles peuvent déposer une plainte dans un délai raisonnable. Mais quand il s’agit d’une industrie fragmentée, avec des centaines d’opérateurs, le délai est long. La loi devrait réfléchir sur les moyens de faciliter la démarche aux petites et moyennes entreprises. La plainte doit contenir des preuves qu’il y a commerce déloyal et que l’activité nationale subit un préjudice. L’enquête devra démontrer clairement l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage important causé à la branche de production. Cela suppose un temps d’observation. La procédure doit respecter des délais contraignants afin d’instruire la plainte et décider s’il faut prendre des mesures provisoires. Les conditions pour entamer la procédure sont la preuve qu’il y a dumping ou subventions, la preuve qu’il y a préjudice, et la garantie que les mesures compensatoires ne seront pas contraires à l’intérêt général. Or, l’intérêt des producteurs et celui des importateurs est divergent.
L’importateur a intérêt aux importations subventionnées, qui sont à un prix avantageux ; les mesures compensatoires lui font perdre cet avantage, alors que le producteur y gagne. Le nombre d’acteurs qui dépendent des importations s’accroît. Il faut donc se demander si la présomption en faveur des producteurs est toujours pertinente. Cette question risque de susciter beaucoup de tensions. Il est certain que les instruments de défense commerciale sont nécessaires même s’ils sont complexes à mettre en œuvre. Ils relèvent d’une réponse : on agit après les faits. Cette action est un second choix. On peut rêver d’une action à la source, grâce à des contacts bilatéraux et des discussions dissuasives ; mais ce n’est pas réaliste.

