Idées
Le faux débat sur l’IDH du Maroc
Le Maroc ne conteste pas
la réalité des chiffres qui constituent la matière première de l’IDH. Il remet
en cause la pertinence
de l’indice composite.
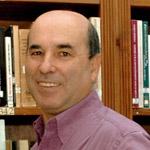
L e Maroc va-t-il progresser ou va-t-il régresser dans le classement social des nations ? Un questionnement récurrent, qui se profile toujours à la veille de la publication du Rapport de développement humain du PNUD. Le millésime 2008 va paraître incessamment. Quelques «fuites» organisées confirmeraient que le score du Maroc s’est encore dégradé. Déjà les «performances» de l’année dernière avaient été mal accueillies par les officiels. Comme celles d’autres années précédentes. La première contestation remonte au début des années 80. Une délégation de la haute administration marocaine avait fait le déplacement au siège de l’institution onusienne pour protester de la maltraitance réservée au pays par la «fabrique» de l’indice. Depuis, à chaque mauvais score, le Maroc manifeste sa mauvaise humeur. Pourtant, l’«output» décrié, c’est-à-dire l’Indicateur de développement humain (IDH) est conçu à partir des statistiques produites par le Maroc. Le PNUD ne fait que construire un indicateur synthétique à partir d’indicateurs partiels produits par les statistiques nationales. «Hadihi bidaâtoukoum rouddate ilaykoum».
Le Maroc ne conteste pas la réalité des chiffres qui constituent la matière première de l’IDH. Il remet en cause la pertinence de l’indice composite : autrement le plat servi, mais pas les ingrédients qui le composent. Il n’est pas le seul pays à être dans cette posture. Tous les mal-classés, rangés dans les catégories de développement humain moyen ou faible n’admettent pas leur positionnement. Le PNUD est assailli de contestations en provenance des quatre coins du monde. Mahmud El Haq, respectable inventeur de ce concept/indicateur, devient un personnage honni par les officiels des pays mal classés. Pourtant, l’intérêt de l’indicateur de développement humain, créé en 1990 par les Nations Unies, est de prendre en compte les critiques croissantes dont faisait l’objet la mesure du niveau de développement par le seul revenu par habitant. Une mesure qui ne dit rien des inégalités de distribution de richesse. Ni comment celle-ci est utilisée : acheter des armes ou développer le capital humain n’a pas le même impact sur les conditions de vie. L’IDH répond en partie à cette interrogation. Il se construit à partir de trois critères : la longévité, définie par l’espérance de vie; le niveau d’instruction, mesuré par le taux d’alphabétisation des adultes et le nombre d’années d’études; et le pouvoir d’achat des habitants, déterminé par le revenu réel par tête pondéré par le coût de la vie.
Mesurer le développement d’un pays à l’aide d’un indicateur composite présente des limites et une dose d’arbitraire. L’indicateur donne en effet le même poids à trois paramètres différents : l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le niveau de revenu. Or si l’on prend les éléments composites de l’IDH, on constate que pour l’espérance de vie, avec un peu plus de 70 ans, le Maroc se situe au 96e rang et il est difficile de progresser sur cette échelle. En ce qui concerne le critère de l’alphabétisation, il enregistre un plus mauvais score qui plombe son positionnement, quels que soient les progrès réalisés sur les autres indices. Il y a bien sûr la prise en compte du niveau de vie des populations, qui dépend fortement des performances fluctuantes de la croissance et fait plonger le Maroc au 138e rang. Deux des indicateurs sur les trois retenus sont donc défavorables au Maroc : l’éducation et la croissance. Est-ce vraiment surprenant ? De même, l’IDH, qui est une moyenne nationale, masque souvent de fortes inégalités entre les sexes, les régions, les classes de revenus…De ce point de vue, le PNUD a affiné ses approches du développement humain en créant d’autres indicateurs : l’indice de pauvreté humaine ou l’indicateur sexospécifique de développement humain, pour tenir compte des différences hommes/femmes. Enfin, l’IDH, qui se construit à partir de trois critères, exclut de fait les autres, notamment les critères politiques : stabilité des institutions, démocratie, niveau de corruption… Sur ce plan aussi le PNUD produit une série d’indicateurs sur les questions institutionnelles du développement. Or, il est rare de se référer dans le débat public à ces autres indicateurs tout aussi significatifs que l’IDH. L’autre critique adressée à l’IDH est le classement des pays ou leur étalonnage. La dernière publication classe le Maroc au 126e rang derrière l’Egypte, l’Ouzbékistan, le Botswana et la Namibie, etc. Les décideurs n’ont pas le sentiment que le Maroc soit en retard sur les pays cités. L’un des reproches que l’on peut faire à l’indice est qu’il est statique. Or, sur la durée, les rapports du PNUD ne disent pas que l’IDH du Maroc ait régressé. Ils confirment, bien au contraire, qu’il figure parmi les 20 premiers pays dans le monde en termes de rythme et de dynamique de progression de l’IDH. Ce qui peut signifier que d’autres pays ont peut-être progressé davantage que le Maroc. C’est peut être discutable, mais ce n’est pas nécessairement surprenant. Rejeter le classement, c’est manifester son ego, c’est avoir du «nif». C’est peut-être bien pour la dignité. Mais se voiler la face ou tomber dans le narcissisme serait déplorable pour les enseignements à tirer. Le mal ne réside pas dans l’acceptation que le Maroc a moins performé que la Tunisie ou le Kirghizistan dans tel ou tel domaine social. Le mal serait de ne pas en prendre acte et d’ajuster les politiques publiques qui sont à l’origine de ce classement. Quelles que soient les critiques adressées à l’IDH, il n’en reste pas moins un outil utile pour rappeler une évidence : à quoi bon plus de croissance si elle ne sert pas à améliorer le développement humain ? Une question éminemment politique…

