Culture
Ces éditeurs audacieux qui ont parié sur le beau-livre
Le beau-livre, cadeau par excellence, est un créneau difficile pour les éditeurs qui se débattent avec les difficultés techniques liées à sa confection et qui, tenus de réussir la quadrature du cercle, ont du mal à arbitrer entre tirage, prix de revient et lectorat. Quelques-uns d’entre eux, à la fois audacieux et bibliophiles, ont pourtant fait le pari d’y arriver. Portrait d’un secteur à risques.
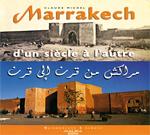
Lemétier d’éditeur, au Maroc, n’engraisse pas son homme. Même les plus grandes maisons en sont souvent réduites à lécher la pelle à tarte plutôt que de goûter le gâteau qui devrait récompenser leur ardeur à l’ouvrage.
Il faut dire que l’acte de lire n’est pas inscrit dans nos gènes culturels. Aussi, le livre se morfond-il en queue de peloton des biens culturels, très loin derrière les DVD, les CD audio et les jeux vidéo. Dès lors, il est surprenant de voir que des éditeurs qui peinent à brader leurs produits n’hésitent pas à s’investir dans le beau-livre. En effet, la mise au point d’un beau-livre n’est pas une sinécure.
Au moins une dizaine d’intervenants sont à pied d’œuvre : l’éditeur, un ou plusieurs auteurs, un ou plusieurs photographes, un photograveur, un maquettiste, un relecteur ou correcteur, un imprimeur… Et comme un beau-livre, pour mériter son appellation, doit être imprimé sur un papier élégant, dont le grammage varie entre 135 et 170 grammes, présenter une iconographie soignée, jouir d’un brochage minutieux et même être protégé par une jaquette, son coût est élevé : il représente celui de 25 romans, nous explique Abdelkader Retnani, directeur d’Eddif et de la Croisée des Chemins, soit 400 000 DH au bas mot.
Prix de revient d’un beau-livre digne de ce nom : 400 000?DH au bas mot
Un tel coût dissuade la plupart des éditeurs de se lancer dans l’aventure. Après la mort prématurée des éditions Shouf, auxquelles on doit un sobre mais très édifiant ouvrage sur le peintre Ahmed Cherkaoui, et de Dedico, qui s’en est allée non sans nous avoir légué un pétillant Maroc somptueux des femmes, apprêté par Rita Khayat, quatre maisons seulement inscrivent le beau-livre sur leur fronton.
Il s’agit de la Croisée des chemins, à laquelle Eddif a concédé le genre en 1993 ; Oum, dont on ne sait pas l’avenir après la disparition de son fondateur, Mohamed Sijelmassi ; Marsam, tenue de main de maître par Rachid Chraïbi ; Malika, qui porte le nom de sa pugnace génitrice, Malika Slaoui, et Senso Unico, filiale de la prestigieuse citadelle milanaise.
Toutes se sont engagées dans la voie tracée par Soden, le premier à introduire le beau-livre dans le paysage éditorial marocain, avec Casablanca, concocté par Jean-Michel Zurflüh. C’était en 1985. Depuis, notre patrimoine s’est enrichi de quelque 120 titres, chiffre qui n’est certes pas mirifique, mais, convenons-en, honorable.
Avec 64 ouvrages, La Croisée des chemins caracole en tête, devançant Marsam (15), que talonne Oum (11), à égalité avec Malika éditions, et loin devant Senso Unico (5). «Le risque d’y laisser des plumes est grand, explique Abdelkader Retnani. C’est pourquoi la plupart des éditeurs publient en moyenne un livre tous les cinq ans. Moi, j’ai été prudent au départ, mais, depuis peu, je me suis fixé pour règle de proposer deux beaux-livres par an. Je ne suis pas un bon exemple».
Premier beau-livre : «Casablanca» de M.?Zurflüh, édité en 1985 par Soden
Quant au tirage, il consituerait, selon Rachid Chraïbi, un véritable «casse-tête». «La sagesse me dicte de ne pas aller au-delà de mille exemplaires. Mais si je dois me suffire de cette quantité, je serai obligé d’évaluer le prix de vente en fonction du coût de revient qui, pour ce tirage, est énorme, et dans ce cas, les acquéreurs ne risquent pas de se bousculer au portillon. A 4 000 exemplaires, le coût est raisonnable, mais vu qu’il y a peu d’amateurs, il m’en resterait plus de la moitié sur les bras.
C’est la quadrature du cercle.» Abdelkader Retnani parie et gagne : «Je suis téméraire. Je sais pertinemment que je joue gros et que je peux y laissser ma chemise, mais je ne tire pas à moins de 4 000 exemplaires. Jusqu’ici, j’ai eu de la veine, je parviens à les écouler en quatre ans».
Le secret de la réussite est de miser sur le bon cheval. En clair, choisir un thème porteur. Ainsi, si les éditeurs privilégient les portraits de villes (Marrakech, 20 beaux-livres ; Tanger, 5 ; Fès, 3 ; Meknès, 2 ; Oujda, 1; Tétouan, 1; Boujaâd, 1; Azemmour, 1…), toutes les villes ne font pas recette.
Marrakech et Fès partent comme des petits pains, d’ouvrages sur Casablanca, on en redemande ; en revanche, Tanger s’en sort péniblement, Tétouan n’intéresse pas grand-monde ; quant aux livres sur Boujaâd ou Azemmour, ils semblent voués au pilon. «Cela ne tient ni à l’intérêt de la ville ni à la facture de l’ouvrage qui la décrit, mais au lectorat qui la compose.
Je suis moi-même fasciné par une cité comme Chefchaouen. Je désire lui consacrer un livre, mais je suis presque sûr que je me planterai. Il y aurait très peu de Chaouni qui aimeraient le mettre dans leur bobliothèque… s’ils en ont une», confirme Abdelkader Retnani. A ce propos, à qui s’adressent les beaux-livres ? Aux fondations, qui en commandent parfois jusqu’à 300 exemplaires, aux entreprises, qui les offrent à leurs cadres à l’occasion du Nouvel An, aux bibliophiles et à l’élite intellectuelle ou artistique.
Outre les villes passionnantes, les éditeurs proposent un regard sur le Maroc (Maroc : deux passions, une mémoire ; Le Maroc : Hommage à Delacroix, 1900-1960 ; Le Maroc, un certain regard ; Le Maroc en mouvement…).
Le beau-livre est redevable de sa survie aux fondations, opérateurs téléphoniques et agences urbaines
Ils mettent en lumière l’art de vivre marocain (Le Maroc somptueux des femmes ; Costumes du Maroc ; Arts et architectures berbères du Maroc ; Parures en or du Maroc ; Maroc, les palais et les jardins royaux ; Jardins du Maroc, d’Espagne et du Portugal…).
A l’adresse des esthètes et des amateurs d’art, ils visitent le patrimoine artistique (Les Tendances de la peinture contemporaine marocaine ; Peinture et mécénat ; Aziz Abou Ali, la fascination de l’absolu ; Un Peintre à Tanger en 1900: Mohamed Abou Ali R’bati ; Hassan El Glaoui, l’homme et l’artiste ; Mehdi Qotbi avant la lettre…).
En dépit de leurs beaux arguments, ces livres n’auraient jamais vu le jour si les éditeurs n’avaient dû compter que sur eux-mêmes, c’est-à-dire sur leurs fonds. Ce sont les fondations bancaires qui viennent à leur rescousse. Essentiellement, la BMCE et la BMCI. La première a mis la main à la tirelire à plusieurs reprises.
Marsam lui doit une fière chandelle pour avoir préacheté Le Maroc somptueux des femmes, repris de Dédico (3000 exemplaires vendus) ; La Croisée des chemins la loue pour l’avoir aidée à sortir Bab Mansour. La BMCI, elle, a pris la bonne habitude de sacrifier une certaine somme à la fabrication d’un beau-livre (Fez dans la cosmographie ; Le Voyage du Sultan Moulay Hassan au Tafilalt, 1900-1960. Maroc, un certain regard; Arts et architectures berbères du Maroc; Sur la voie d’Ibn Al Ârabi ; Casablanca, portrait d’une ville…).
Cela ne veut pas dire que d’autres banques soient près de leurs sous, seulement ils les réservent à la publication de leur patrimoine. A titre d’exemple, 30 ans de mécénat, histoire d’une collection, édité par la BCM.
Les contributions viennent aussi d’autres sources telles Maroc Telecom (Le Temps des jardins princiers du Maroc), l’Agence du Sud, grâce à laquelle Marsam à pu éditer Al Khaïma, la tempête noire du désert ; Secrets du Sud ; Les Gravures rupestres de la région de Smara.
Pour alléger les frais, il existe également la possibilité d’éditer le beau-livre à deux mains. «Si on décide de tirer à 4 000 exemplaires, les coéditeurs se partagent la charge pécuniaire», précise Rachid Chraïbi. La recette fonctionne, c’est pourquoi beaucoup l’adoptent. Par exemple, Malika avec Actes Sud (Artisans du Maroc), Maisonneuve et La rose (Marrakech, d’un siècle à l’autre), l’Institut du Monde arabe – IMA (L’Appel du Maroc).
Sans la générosité des uns, la solidarité des autres et l’abnégation d’une poignée d’éditeurs, le beau-livre, au Maroc, serait depuis belle lurette mort et enterré. Aujourd’hui, il ressemble au roseau pascalien qui plie mais ne rompt pas. Jusqu’à quand ?

