Société
Peur, stress et anxiété largement associés à la Covid-19
• Les personnes testées positives au virus se retrouvent dans une situation particulière.
• Les patients ont également peur aussi bien pour leur entourage proche que celui indirect.
• L’organisation des circuits sanitaires n’est pas non plus rassurante et présente de réels risques de contamination.
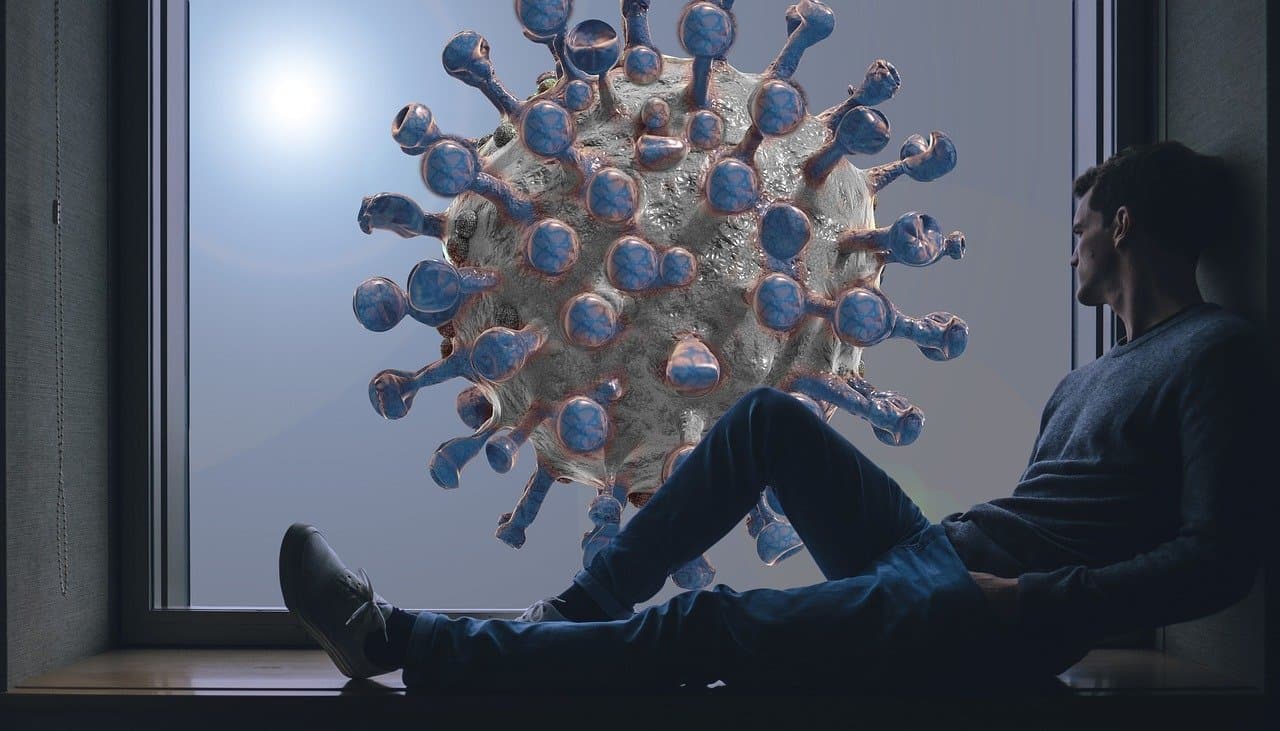
Etre atteint de la Covid-19 est une épreuve éprouvante et angoissante. D’abord parce que le virus n’est pas très bien connu et non encore bien cerné. Ensuite parce que l’actuel traitement, composé d’antibiotiques, de vitamines et de chloroquine dans les hôpitaux, n’est prescrit qu’à titre expérimental et n’est pas totalement adapté. Ce qui n’est pas très rassurant lorsque les médecins l’expliquent aux patients, et ne fait, au contraire, qu’augmenter la peur, l’angoisse et l’anxiété. Le stress ponctue également le quotidien des patients en isolement qui passent leur temps à l’écoute de leur organisme, détectant les moindres gênes, les moindres maux, essayant de les interpréter à l’aide de recherche sur Internet. Plus angoissant encore, les risques de propagation et de contamination rencontrés par les patients dans les structures de soins, qu’elles soient privées ou publiques.
Jusqu’à présent, l’on a presque focalisé les reproches, et à juste titre d’ailleurs, sur les citoyens qui n’observent pas les gestes barrières (distanciation, port du masque etc.), mais l’on a pas beaucoup soulevé les ratés et les dysfonctionnements du circuit de prise en charge qui exposent à de grands risques de contamination et de retards dans les diagnostics et les traitements. Plusieurs personnes testées positives en témoignent.
Fatima, on l’appellera ainsi, s’est adressée à un hôpital casablancais pour faire le test, trois jours après l’apparition des premiers symptômes, notamment maux de tête et asthénie. Réponse : «Non, on ne peut pas vous faire le test, il faut avoir une prescription du médecin du centre de santé de proximité !». Retour le lendemain avec la prescription, elle attendra quatre heures avant de passer son test. «Une longue attente dans une enceinte où la distanciation n’est pas respectée et où plusieurs agents de sécurité et autres chargés de l’accueil des patients ne portent pas de bavettes!». Elle ne saura que quarante-huit heures après qu’elle a la Covid-19. Elle se dirige vers le centre de santé de proximité pour récupérer son traitement. «Mais, comme je suis arrivée à 14h, on m’a dit que le médecin n’était pas là et qu’il fallait revenir le lendemain à 9 heures. Longue file d’attente le lendemain pour finalement n’avoir que la chloroquine que je n’ai pas prise et j’ai dû acheter les autres médicaments. Ainsi, j’ai eu un retard de trois jours sur mon traitement !».
Pour Khalid, 22 ans, également testé positif, «l’expérience à l’hôpital a été traumatisante. J’ai attendu de 8h30 le matin, l’heure à laquelle la délégation régionale de la santé m’a demandé de me présenter à l’hôpital, jusqu’à 17 h 30. Au-delà du retard, j’ai aussi eu peur, parce qu’il y avait un risque flagrant de contamination. Les personnes atteintes du virus et celles venues consulter pour d’autres pathologies se côtoient dans la salle d’attente !».
Assurer des permanences dans les centres de santé, envoyer les résultats par SMS pour réduire les risques…
Lorsque le patient atteint du virus s’adresse au secteur privé, il n’échappe pas non plus à certains dysfonctionnements. Les laboratoires autorisés ont certes des espaces «Covid-19» qui ne sont pas, faut-il le souligner, aussi isolés qu’il faudrait. Khadija, autre témoin, raconte «avoir traversé deux espaces du laboratoire pour accéder à celui dédié au test de la Covid-19. Dans la salle d’attente, certes aérée, la distanciation entre les patients n’est pas très observée, les formulaires à remplir sont disposés pêle-mêle sur une table et tout le monde, atteint ou pas du virus, vient se servir et, encore plus grave, un seul stylo est mis à la disposition des patients !». Après avoir eu le résultat de son test, elle s’est rendue chez le pneumologue qui reçoit, dans la même salle d’attente, tous les patients ! «Pourquoi les médecins ne réservent-ils pas une salle d’attente dédiée pour les patients dépistés positifs ?». Dans la clinique où elle s’est rendue pour les examens radiologiques, «même désorganisation et des tarifs élevés: 3 000 dirhams pour une consultation et les examens radiologiques. Et il faut prendre rendez-vous pour deux à trois jours plus tard. Des allers-retours dans bien des cas au moyen des transports communs qui augmentent le risque de contamination !».
Pour la communication des résultats des tests, les laboratoires demandent les numéros de téléphone et les adresses mail, seulement ces moyens ne sont pas utilisés pour envoyer les résultats. On demande aux patients de revenir, en général entre 11 et 13 heures, pour les récupérer auprès de l’accueil où l’on reçoit également les autres patients. Et seuls quelques privilégiés peuvent se voir adresser un SMS ou bien un mail.
Les allers-retours des patients non motorisés augmentent également les risques de contamination via les transports publics. Fatima, notre premier témoin, s’est rendue trois fois en 24 heures à l’hôpital par bus ! Sans compter qu’elle a dû aussi se déplacer au centre de santé dont elle relève deux fois au cours desquels, espace réduit oblige, elle a côtoyé des personnes non affectées par le Coronavirus !
Par ailleurs, et pour éviter les retards au niveau du démarrage du traitement, ne faudrait-il pas assurer des permanences dans les centres de santé afin de fournir les médicaments et les prescriptions de tests à temps ?
Une meilleure organisation logistique permettrait de gagner du temps, de réduire les risques de contamination et surtout de tranquilliser les patients qui subissent un énorme stress. Selon des psychologues, le stress est à 70% responsable de l’état de santé des patients qui ne sont pas des cas critiques : «Stress et peur pour soi de ce virus pas encore très bien cerné, pour l’entourage proche et aussi l’entourage indirect côtoyé dans les laboratoires, les cabinets de médecins, cliniques et laboratoires. Sans compter que les personnes atteintes sont très nombreuses, contrairement à ce que l’on peut croire, à le cacher aux voisins et même à la famille car ils ont peur de la stigmatisation !»

