Culture
Six-cents-artistes et une marée humaine attendus pour Timitar III
Toujours à cheval sur ses principes d’éclectisme, de non-exclusivisme et de partage,
Timitar sera au rendez-vous, du 11 au 16 juillet, à Agadir, avec, dans
sa besace, des moments
de grà¢ce et d’émotion. Histoire d’une étoile
qui ne cesse de monter.
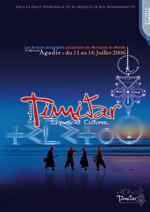
Agadir bouge et nul ne s’en plaint. Surtout pas les gens du cru qui, lors de la conférence de presse tenue le 18 mai dernier, ont couvert d’éloges le Festival Timitar. Des propos qui ont dû réchauffer le cÅ“ur anxieux de Abdellah Rhallam, président de l’Association Timitar, Fatima-Zahra Ammor et Brahim El Mazned respectivement directrice et directeur artistique de Timitar. Ce dernier ne dissimule pas sa satisfaction : «C’est un motif de fierté pour nous que cette reconnaissance spontanée de la qualité du travail fourni par des gens exigeants. Cela nous incite à décupler nos efforts pour demeurer à la hauteur de leur confiance». Celle-ci n’est pas près d’être trahie, tant le festival a pris un départ flamboyant. De fait, Timitar a pris la ville par surprise, s’imposant en seulement deux éditions avec un mélange de raffinement amazigh et de clins d’Å“il aux diverses musiques du monde, faisant ainsi mentir les prédictions des oiseaux de mauvais augure, qui annonçaient sa mort dans l’Å“uf.
Pour certains, Timitar devait être, au mieux, l’éternel petit frère des autres festivals
Les plus optimistes ne s’attendaient pas à ce que Timitar passât la rampe d’emblée et encore moins à ce qu’il damât le pion à certaines manifestations indécrochables, dans la foulée desquelles il est né. Au mieux, croyaient-ils, il serait l’éternel petit frère en matière de festival musical. En pourrait-il être autrement quand on a l’infortune d’éclore dans un climat peu propice aux floraisons culturelles. Agadir, prétendait-on, aurait vocation seulement à faire dorer sur sable fin les chairs pâlottes. Vouloir la convertir en un haut lieu musical relèverait de la gageure insensée. Mais de donner à Agadir une dimension culturelle, quelques natifs influents en ont longtemps secrètement rêvé, pour ensuite passer à l’acte. En juillet 2004, Timitar connut son baptême du feu, il ne se brûla pas, comme attendu, il enflamma de façon inespérée.
Le secret de cette fascination fulgurante était lié aux vertus de la programmation. Abondante (37 concerts en quatre jours), audacieuse, parfois inédite et franchement éclectique. Cette première saison de Timitar fut semée de fêtes impromptues, de moments de convivialité et de plaisirs non prémédités. Tels qu’un tête-à -tête avec un raà¯s dans sa loge, un pot pris avec un connaisseur des nachads, une participation à une «teuf» branchée avec DJ, mix et remix, une balade sur la plage o๠des jeunots, après le spectacle, poussaient, avec conviction, la chansonnette… C’est cette part d’inattendu qui avait rehaussé l’attrait de la première édition. Et les Gadiris, généralement casaniers, n’étaient pas les derniers à tomber sous le charme. Pas seulement du festival, mais aussi de leur propre ville, qu’ils découvraient sous un jour nouveau. «Je suis un couche-tôt, nous confiait un bazariste. Le jour, je ne quitte ma boutique que pour me rendre à la mosquée. Après la prière du soir, je rentre directement chez moi. Ce n’est qu’à l’occasion du festival que je me suis promené un peu à travers la ville. J’ai eu le sentiment de la découvrir».
L’édition 2004 permit de dissiper un malentendu. En effet, à l’annonce de la naissance de Timitar, ils étaient nombreux à croire que ce dernier allait privilégier la musique amazighe. Il est vrai que celle-ci eut la part belle, avec Tissent, Aglagal, Taghbaloute, Lakfifate, Akhattab, Amina Demsiriya, Lhoucein Amentag… Il n’en est pas moins vrai que d’autres musiques étaient aussi de la fête, et l’on passait allègrement des rwaà¯s aux Tambours du Bronx, puis au hassani, au reggae, au flamenco, à la chanson engagée avec Marcel Khalifa, pour finir dans les bras du jazz de Randy Weston. Pas question de genre, de chapelle ou d’époque. Timitar ingurgitait, regurgitait tous les airs, les rythmes et les sons, honorant ainsi son engagement de former une vitrine de la création musicographique, sans exclusive, sinon celle de la qualité.
Une vitrine musicographique sans exclusive
A cet égard, Brahim El Mazned, qui porte le festival depuis le début, se montre ferme : «J’essaie de faire le moins possible de concessions. Il faut avoir le courage de refuser un artiste même si on sait d’avance qu’il va remplir la salle mais risque de brouiller l’image du lieu. J’aime tout type de musique, du rock hardcore à la musique amazighe, du hip-hop à la musique confrérique, du reggae à la salsa… Mais, ce qui importe à mes yeux, c’est la dimension humaine. Je n’éprouve aucune sympathie pour ceux qui prennent la pose de la star, avec tous les désagréments qu’elle impose. Je suis sensible aux artistes qui font preuve d’humilité, de générosité et de grandeur d’âme».
De ces saines dispositions, les artistes invités à Timitar II étaient pétris. Et d’immense talent aussi. Le Sénégalais Ismaà«l Lô, qui eut le redoutable honneur d’ouvrir le bal, fit chavirer le public avant de le plonger dans le délice quand il entonna, d’une voix solaire, sa chanson Africa. Le groupe Oudaden, qui prit la suite, embrasa l’assistance, puis Nass El Ghiwane, plus électriques que jamais, vinrent souffler sur les braises. Au feu ! Le reste fut aussi incandescent, de part en part. A la place Al Amal, Alpha Blondy mit le public dans tous ses états, les meilleurs surtout. Lotfi Bouchnak, Washm, Rum Tariq Al Nasser Group, Totô La Momposina ou Aà¯cha Tachinouite illuminèrent le théâtre de verdure. La scène Bijaouane révéla toute la capacité d’indignation rageuse dont est capable le groupe Gnawa Diffusion et montra que nos jeunes rappeurs ne sont pas des manchots. Tout cela dans une atmosphère bon enfant, fraternelle et enjouée. Ce qui fait que les autorités travaillèrent volontiers avec ce festival bouillonnant, qui n’a rencontré aucune résistance, ni de la part des agents de sécurité ni de celle des habitants. Salué au-delà d’Agadir, Timitar, en deux tours, nourrit l’orgueil local, dans une ville devenue soucieuse de rayonnement et d’affirmation culturelle, face à Fès, Marrakech, Essaouira ou Tanger, qui la regardaient de haut.
Une IIIe édition regorgeant d’emblèmes et de têtes d’affiche
La IIIe édition de Timitar s’ouvre mardi 11 juillet à 19 h, et durera jusqu’au dimanche 16 juillet, et tout le monde s’accorde déjà à reconnaà®tre la réussite, tant les organisateurs ont mis le paquet. Six-cents artistes, 50 groupes, 56 concerts en six jours. De quoi apaiser les fringales les plus irrésistibles. Des têtes d’affiche à satiété mais dont on ne se rassasie jamais : Jimmy Cliff, Ammouri M’barek, Jil Jilala, Oumou Sangaé, Cheikh Lô, Sergent Garcia, Orchestre National de Barbès, Hadda Ouaki, Yuri Buenaventura, Cheb Mami…, un éventail de voix rauques ou voilées, nasillardes ou sensuelles, mordantes ou suaves, douces ou puissantes, celles de Najat Atabou, Karima Skalli, Oumghil, Chérifa, Tihihite, Archach-Ali Chouhade, Aârab Atigui, Mohamed Maghni ou Aà¯cha, pour ne citer que celles qui nous sont familières. Un voyage en musique parmi les genres et les continents : les groupes traditionnels amazighs (Aglagal, Ouad Haha, Taskiwine, Daqat Saif, Ahwach Telwet, Ajmak Souss), qui auront chaque jour le privilège d’inaugurer la soirée sur la place Al Amal ; le reggae jamaà¯cain (Jimmy Cliff,) ; le protest song marocain (Jil Jilala) ; le chant spirituel arabe (Karima Skalli), ; le chaâbi marocain (Najat Atabou) ; la chanson griotte (Malouma) ; la musique électronique (Lo’Jo) ; la world music (Cheikh Lô) ; les rwaà¯s (Aârab Atigui), le hip-hop marocain (H-Kayne) ; la musique kurde (Kamkars) ; le ra௠(Cheb Mami) ; la salsa (Yuri Buenaventura)… et tant et tant d’airs, de rythmes et sons, parfois doux, parfois survoltés, tantôt hybrides, souvent ébouriffants.
Timitar, qui est passé de 400 000 visiteurs lors de la première édition en 2004 à 600 000 l’an dernier, est sûr d’un score himalayen. Ainsi, la soirée d’ouverture, dont l’affiche se compose d’Aglagal, Jimmy Cliff, Amouri M’barek et Jil Jilala, est bien partie pour être un des pics de fréquentation d’une édition fort alléchante. Les autres soirées ne seront pas en reste, et il faudra écourter sa séance de bronzette pour se frayer un chemin vers la place Al Amal, dimanche 16 juillet, vu qu’il s’y produira un certain Mami, icône des jeunes et des moins jeunes Marocains.
En substance, une programmation à rendre fous les plus blasés. Il y aura des flots humains devant le portillon faute de places disponibles. Timitar devrait songer à multiplier ses sites. Il grandit vite, il faut que ses artères suivent.
|
||
La Vie éco : Timitar, de l’avis général, prend du galon malgré son jeune âge. Partagez-vous ce sentiment ? C’est pourquoi vous avez mis les petits plats dans les grands ? Y a-t-il un profil type du visiteur de Timitar ? |
||
